Les membres du laboratoire
Chercheurs permanents
Alexandre BRUN
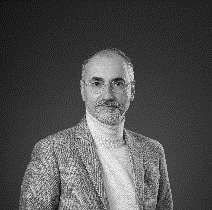
MEMBRE PERMANENT
Membre permanent
| Fonction actuelle |
Maître de conférences HDR |
| spécialité |
Géographie, Aménagement, Urbanisme |
| responsabilités |
|
| DOMAINES DE RECHERCHE ET D’EXPERTISE | Ses travaux portent sur les rapports eaux-territoires. La ville résiliente, l’urbanisme littoral, les politiques de l’eau et la renaturation des territoires ainsi que le risque inondation dans les métropoles sont quelques-uns de ses thèmes de recherche développés en France et au Canada. Il enseigne le projet, l’aménagement et la prospective territoriale en master, la géographie de la France et l’aménagement du territoire en licence. Il a contribué à une douzaine de projets urbains en France au sein d’équipes de maîtrise d’œuvre (études de définition, programmation, etc.) et mené des missions d’expertise pour des collectivités (conseils départementaux, établissements publics…). Il a récemment été auditionné par la Cour des Comptes et le Conseil d’Analyse Economique du Premier Ministre. |
| terrains d’études | Grand Paris, Lyon, Montpellier, Bretagne, littoral d’Occitanie, bassin versant de la Dordogne, bassin versant de la Neste, Québec, Montréal, Nord du Québec |
| collaborations SCIENTIFIQUES |
|
| RECHERCHEs en cours |
|
| (co-)direction de thèses |
Amélie Legay : Projets urbains et pénurie foncière dans les métropoles : le cas du Grand Lyon. Thèse CIFRE (SERL) en codirection avec Laurent Chapelon (LAGAM) Llewella Maléfant : Vieillissement de la population et aménagement du territoire : analyse dans les territoires de faible densité. Contrat doctoral avec financement Crédit Agricole Centre France et Euryal Asset Management. Neyla Meddha : La monographie territoriale à l’épreuve des transformations politiques : développement urbain et aménagement dans la ville de Bizerte en codirection avec Yassine Turki (Université de Tunis) Manuela Habib : Résilience urbaine et approche systémique des risques. Analyse du processus d’adaptation du quartier de Mar Mikhael à Beyrouth après l’explosion de la zone industrialo-portuaire en 2020. En codirection avec Nancy De Richemond (LAGAM) |
Lucile MÉDINA

Lucile MÉDINA
| Fonction actuelle |
Professeur des universités
|
| spécialité |
Géographie du développement, frontières, Amérique latine
|
| responsabilités |
– Directrice du Département de Géographie, Université Paul Valéry Montpellier 3 depuis juillet 2021 – Co-responsable de l’axe 2 (Recomposiciones territoriales, entre procesos identitarios y dinámicas normativas) du LMI Mésomamérique depuis 2019 – Co-responsable du Master Études du Développement, Université Montpellier 3, depuis 2015 – Élue au Conseil de la Faculté de Sciences humaines et environnementales de l’Université Montpellier 3, depuis 2018 |
| DOMAINES DE RECHERCHE ET D’EXPERTISE | Mes recherches portent sur les dynamiques de développement en Amérique latine, plus spécifiquement sur les espaces frontaliers : interactions socio-économiques (migrations, identités), conflits, politiques de développement et de coopérations transfrontalières |
| terrains d’études | Amérique centrale, Mexique |
| collaborations SCIENTIFIQUES |
Membre du Laboratoire Mixte International MESO (IRD) Porteuse d’une convention avec l’Université du Costa Rica |
| RECHERCHEs en cours | ASH (Analyse multidimensionnelle des retombées de cendres de l’éruption volcanique de la Cumbre Vieja, La Palma), AAP Evènements rares |
| (co-)direction de thèses | Sandra GUTIERREZ : Approches des pratiques quotidiennes de la gestion de l’eau en Amérique centrale |
Frédéric LEONE

Frédéric LEONE
Membre permanent
| Fonction actuelle |
Professeur des universités
|
| spécialité |
Géographie des catastrophes et des risques naturels
|
| responsabilités |
|
| DOMAINES DE RECHERCHE ET D’EXPERTISE | Frédéric Leone est professeur au département de Géographie de l’Université Paul Valéry Montpellier 3 (UPVM3) et directeur du Laboratoire de Géographie et d’Aménagement de Montpellier (LAGAM). Ses recherches portent sur la reconstitution spatiale des catastrophes naturelles (volcanisme, tsunamis, mouvements de terrain, cyclones, submersion marine), l’évaluation intégrée des risques associés (géo-indicateurs, diagnostics de vulnérabilité) et l’aide à la gestion de crise (plans d’évacuation, cartographies, modélisation, accessibilité territoriale, SIG). Il a participé à plusieurs retours d’expérience dans la Caraïbe, en Asie du Sud-Est, Méditerranée et Pacifique. Ses activités contribuent plus généralement à la prévention des risques naturels et à la promotion d’une géographie appliquée, en particulier dans les pays du Sud. Il est cofondateur du parcours de Master 1&2 en Gestion des Catastrophes et des Risques Naturels (GCRN) de l’UPVM3. Il codirige la collection « Géorisques » aux Presses Universitaires de la Méditerranée. Il est également responsable de deux modules d’enseignement consacrés à la gestion territoriale des risques naturels à l’ENA Strasbourg (Mastère MPGTR) et à la faculté de médecine de l’université de Kinshasa (Master Ecom-Alger). |
| terrains d’études | Antilles, Mayotte, Maroc, Vanuatu, Tanzanie, Philippines, Alpes françaises |
| collaborations SCIENTIFIQUES |
|
| RECHERCHEs en cours |
|
| (co-)direction de thèses |
|
Freddy VINET

Freddy VINET
Membre permanent
| Fonction actuelle | |
| spécialité |
Géographie des risques
|
| responsabilités |
|
| DOMAINES DE RECHERCHE ET D’EXPERTISE | Dr Freddy Vinet is a professor of geography at university of Paul-Valery Montpellier 3 (France) with a 25 years experience in teaching and searching on the impacts of natural hazards and their prevention. He participated to numerous field studies on the vulnerability of coastal areas after the 2004 tsunami in Indonesia, after the sea surge “Xynthia” in western France (2010) and hurricane Irma in lesser Antillas (2017). He is the head of a master degree “disaster risk management” teaching students on methods (especially GIS) to handle natural hazards. His most recent major publication is a 2-volume handbook on floods : Floods 1 : risk knowledge and Floods 2 risk management (Iste Editor) He also published a comprehensive book on the Spanish Flu (1918-1919), the deadliest disaster of the 20th century. |
| terrains d’études |
Europe, Antilles, Bassin Méditerranéen, Afrique |
| collaborations SCIENTIFIQUES |
|
| RECHERCHEs en cours |
|
| (co-)direction de thèses |
|
Stéphanie DEFOSSEZ

Stéphanie DEFOSSEZ
Membre permanent
| Fonction actuelle |
Maître de Conférences
|
| spécialité |
Géographie des risques naturels
|
| responsabilités |
Scientifiques :
Administratives :
Pédagogiques :
|
| DOMAINES DE RECHERCHE ET D’EXPERTISE |
Stéphanie Defossez est maître de conférences en géographie à l’université Paul-Valéry-Montpellier 3 au sein du département de géographie-aménagement et de l’UR LAGAM. Géographe de formation, elle s’intéresse aux problématiques des risques et catastrophes naturels dans une volonté d’approche globale même si l’approche enjeux-vulnérabilités centrés est privilégiée. Ses recherches portent sur la gestion des risques et des crises à travers notamment l’évaluation des politiques publiques et la prise en considération des perceptions des populations (maîtrise des techniques d’enquêtes). Des approches a priori visant l’anticipation des évènements complètent les retours d’expérience menés sur des évènements hydrométéorologiques. L’analyse territoriale et la spatialisation des informations alimentent son approche systémique et tend à servir sinon la décision au moins la réflexion sur les modes de prévention. Ses problématiques et méthodes s’appuient sur des recherches en France métropolitaine (Méditerranée, Atlantique), dans les territoires d’outre-mer (Antilles françaises) et dans les pays du sud (Cambodge, Vanuatu, Tanzanie). |
| terrains d’études |
France méditerranéenne, Antilles françaises, Tanzanie, Asie, Vanuatu, |
| collaborations SCIENTIFIQUES |
|
| rECHERCHEs en cours |
|
| (co-)direction de thèses | , |
Monique GHERARDI

Monique GHERARDI
Membre permanent
| Fonction actuelle |
Ingénieur d’études en Sciences de l’information géographique
|
| spécialité |
Géographie
|
| responsabilités |
|
| DOMAINES DE RECHERCHE ET D’EXPERTISE |
Ingénieure d’études en Sciences de l’Information Géographiques au sein de l’Université Paul-Valéry Montpellier 3 (UPVM3) depuis 2004, j’exerce actuellement mes fonctions au sein du Laboratoire de Géographie et d’Aménagement de Montpellier (LAGAM / UPVM3). Mes 20 années d’expériences en Systèmes d’Information Géographique (SIG) et cartographie, en qualité d’ingénieure ou de chargée d’études dans différentes équipes, me permettent de justifier d’une activité de recherche continue au service des collectifs scientifiques et de capacités d’adaptation au sein de plusieurs équipes de recherche (MTE, GESTER, UMR GRED). J’ai ainsi été associée à 21 projets de recherche et/ou expertises scientifiques dont 6 projets ANR. L’atlas de la ruralité mahoraise que j’ai dirigé est publié aux éditions Orphie. Pour mener à bien ce projet, j’ai effectué 10 missions de terrain à Mayotte depuis 2021. Je suis également impliquée dans la formation et le suivi d’étudiants de masters, au sein de modules de cours en SIG, sous le logiciel ArcGis. Depuis mars 2020, je suis élue dans mon village de Beaulieu, en charge de l’urbanisme, risques naturels et environnement. Ce nouvel engagement citoyen me permet d’agir comme acteur de l’aménagement du territoire en mettant à profit mes expériences professionnelles au service de l’action publique, et de nourrir en retour mes compétences universitaires dans un objectif de recherche-action |
| terrains d’études | France, Outre-mer, Maghreb, Tanzanie |
| collaborations SCIENTIFIQUES |
|
| RECHERCHEs en cours |
|
Laurent CHAPELON

Laurent CHAPELON
Membre permanent
| Fonction actuelle |
Professeur d’Aménagement de l’espace, Urbanisme – Université Paul-Valéry Montpellier 3
|
| spécialité |
Aménagement, transports, mobilités, réseaux
|
| responsabilités |
Scientifiques
Administratives
Pédagogiques
|
| DOMAINES DE RECHERCHE ET D’EXPERTISE | Recherches sur l’application des théories et méthodes de l’analyse spatiale aux problématiques d’aménagement du territoire, de transport et de mobilité durable. Intérêt particulier porté à l’évaluation de la performance territoriale des systèmes de transport et des solutions intermodales et innovantes de déplacement. Participation depuis 30 ans à l’expertise de grands projets, plans et schémas de transport en France et à l’étranger |
| terrains d’études |
Europe France Afrique |
| collaborations SCIENTIFIQUES |
ENTPE, UMR CNRS LAET Lyon, UMR CNRS ESO Rennes, LVMT (Université Gustave Eiffel) Paris, UMR CNRS PACTE Grenoble, UMR CNRS ThéMA Besançon, Université du Québec (UQAM) Montréal, Université de Lausanne (Unil), UMR ART-Dev Montpellier, Université Toulouse 2 Jean-Jaurès, Université Toulouse 3 Paul Sabatier, IRSTEA, CEREMA, SNCF, Région Occitanie, Département de l’Hérault, Montpellier Méditerranée Métropole
|
| RECHERCHEs en cours |
|
| (co-)direction de thèses |
|
Tony REY

MEMBRE PERMANENT
Membre permanent
Amadou DIOP

MEMBRE PERMANENT
Membre permanent
| Fonction actuelle |
Professeur Titulaire de classe exceptionnelle
|
| spécialité |
Aménagement et développement territorial
|
| responsabilités |
Responsable de la Revue Territoires d’Afrique (www.territoires-dafrique.org)
|
| DOMAINES DE RECHERCHE ET D’EXPERTISE | Professeur titulaire de classe exceptionnelle en géographie de l’aménagement, enseigne à l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar, il est membre du laboratoire LAGAM (Université Paul Valéry de Montpellier). Praticien du développement territorial, il est à ce titre coordonnateur du GERAD. Il possède une expérience professionnelle de plus de 20 ans en Afrique de l’Ouest (Sénégal, Côte d’Ivoire, Niger, Gambie, Mali, Nigeria, Ghana, Bénin et au Burkina Faso) dans l’élaboration de stratégies de développement urbain ou d’aménagement du territoire. |
| terrains d’études |
Sénégal, Mali, Côte d’ivoire, République du Congo, Zone UEMOA, Tchad |
| collaborations SCIENTIFIQUES |
Organismes, universités, etc.
|
| RECHERCHEs en cours |
|
| (co-)direction de thèses |
|
Raffaele CATTEDRA
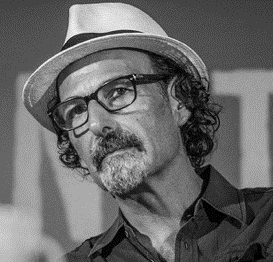
Raffaele CATTEDRA
Membre permanent
| Fonction actuelle |
Professeur des universités (en détachement)
|
| spécialité |
Géographie urbaine (gouvernance, questions patrimoniales espaces publics, projets urbains) et processus de territorialisation à l’échelle du bassin de la Méditerranée
|
| responsabilités |
Depuis 2016 : membro della Giunta del Dipartimento Storia, Beni Culturali, Territorio dell’Università degli studi di Cagliari
|
| DOMAINES DE RECHERCHE ET D’EXPERTISE |
Professeur de géographie et aménagement à l’Université Montpellier 3, actuellement en disponibilité, enseigne à l’Université de Cagliari (Italie). Formé à l’Istituto Universitario Orientale de Naples, il a été allocataire de recherche (1994-97) à l’IRMC Rabat- Marcoc; a soutenu sa thèse à l’Université de Tours (UMR Urbama), sur La Mosquée et la Cité. La reconversion symbolique du projet urbain à Casablanca, (mis en ligne en 2010 par Crévilles.org http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00450366/fr/). Auteur de plus de 150 travaux, il s’occupe principalement de géographie urbaine (gouvernance, questions patrimoniales espaces publics, projets urbains), de migrations et des processus de territorialisation à l’échelle du bassin de la Méditerranée, il développe par ailleurs une approche de plus en plus ouverte aux méthodes multimédia de la géographie |
| terrains d’études |
Maroc, Tunisie, Italie, France |
| collaborations SCIENTIFIQUES |
Université de Tours EMAM-CITERES, IRMC Tunis, Manouba Tunis, Univ. Mohammed V Rabat, Université SA Diopp, Dakar, Paris Nanterre |
| RECHERCHEs en cours |
|
| (co-)direction de thèses |
ATZENI Cinzia : Mobilités. Représentations hégémoniques et contre-récits des mobilités dans l’espace migratoire afro-européen: pour une cartographie participative des migrants, Université de Cagliari Depuis 2007 : direction de 9 thèses de doctorat (dont 2 en cotutelle France/Italie) |
Nancy MESCHINET DE RICHEMOND

Nancy MESCHINET DE RICHEMOND
Membre permanent
| Fonction actuelle |
Professeure des universités |
| spécialité |
Risques naturels, environnement, approche historique des risques et des catastrophes
|
| responsabilités |
|
| DOMAINES DE RECHERCHE ET D’EXPERTISE | Nancy Meschinet de Richemond est professeure de géographie à l’Université Paul Valéry-Montpellier 3. Ses recherches portent sur l’articulation, à différentes échelles spatiales et temporelles, entre les risques naturels (inondation, tsunami) et le(s) territoire(s) des sociétés vulnérables à ces risques dans une perspective géohistorique et systémique. Elle s’intéresse particulièrement au rôle des héritages historiques dans les décalages existant entre la prévention et la gestion effective des risques et des crises (héritages politiques, administratifs, culturels…), en lien avec les différentes vulnérabilités (matérielles, structurelles, fonctionnelles) des territoires et des acteurs. Ses thèmes d’intérêt sont la gestion et la prévention des risques naturels, les jeux d’acteurs, l’évaluation et la perception des catastrophes, des dégâts et des indemnisations (interroger le statut et les limites spatio-temporelles des catastrophes, contextualiser le cadre de pensée des risques). Agrégée de géographie, Nancy de Richemond enseigne du niveau L1 au master et doctorat, a été responsable du dispositif IDEFI au sein du département de Géographie-Aménagement (2013-2017), et siège régulièrement depuis 2004 dans des jurys de concours (ENS, agrégation). |
| terrains d’études | Domaine méditerranéen, Pyrénées, France, Europe, Maroc, RDC |
| collaborations SCIENTIFIQUES |
|
| RECHERCHEs en cours | Projet POST (Penser les sOrties de guerre au prisme des politiques des reSsources et des crises naTurelles) |
| (co-)direction de thèses |
|
Jean-Marie MIOSSEC

Jean-Marie MIOSSEC
Membre permanent
| Fonction actuelle |
Professeur émérite classe exceptionnelle
|
| spécialité |
Géographie
|
| responsabilités |
|
| DOMAINES DE RECHERCHE ET D’EXPERTISE |
Professeur de géographie-aménagement et effectuant aussi des expertises dans ce champ scientifique appliqué, je pratique une géographie totale associant les aspects naturels, humains, économiques, sociétaux, géopolitiques, identitaires et les politiques publiques et privées menées pour aménager ces territoires. Le champ géographique privilégié, suivi sans interruption depuis 1971, est la Tunisie où j’ai été en poste à l’université pendant dix ans (1971-1980). Les investigations sont menées régulièrement également sur l’ensemble du monde arabe (la quasi totalité des pays arabes a été visitée et investiguée lors de missions, la plupart à de nombreuses reprises), avec un focus particulier sur les pays arabes suivants : Tunisie, Liban, Syrie, Algérie, Maroc, Libye, Egypte, Yemen, Djibouti, Somaliland. La recherche s’articule autour de six axes essentiels : – Identités et territoires (France, Europe, monde arabe) – Aménagement, Gouvernance des territoires, Géographie des Territoires (Grands ensembles, Nations, Régions) (France, Europe, Méditerranée, Monde arabe, Afrique de l’Ouest) – Géographie et aménagement des littoraux touristiques – Géographie urbaine et urbanisme – Géographie et géopolitique des mers, des océans et des littoraux – Géographie du bassin méditerranéen et du monde arabe |
| terrains d’études |
Les aires géographiques et pays : – Europe, Méditerranée Nord, France, Malte, Allemagne, très partiellement Roumanie, Turquie, Italie, Slovénie, Albanie. – Monde arabe, Méditerranée Sud, Tunisie, Algérie, Maroc, Syrie, Liban, Egypte, Djibouti, très partiellement Libye, Arabie saoudite, Koweit, Somaliland. – Afrique de l’Ouest, Sénégal, Côte d’Ivoire, Bénin. – Singapour |
| collaborations SCIENTIFIQUES |
UEMOA
|
| RECHERCHEs en cours | Rédacteur des termes de références de l’appel d’offre international relatif au SDER (Schéma de Développement de l’Espace Régional) de l’UEMOA (Union économique et monétaire de l’Afrique de l’Ouest) |
| (co-)direction de thèses | |
| PUBLICATIONS | https://hal.archives-ouvertes.fr/search/index/?q=jean-marie+miossec+&submit= |
Philippe LE GRUSSE

Philippe LE GRUSSE
Membre permanent
| Fonction actuelle |
Enseignant-Chercheur au CIHEAM-IAMM Centre International de Hautes Etudes Agronomiques Méditerranéennes |
| spécialité |
Gestion Agricole, Territoires et Environnement
|
| responsabilités |
|
| DOMAINES DE RECHERCHE ET D’EXPERTISE |
Philippe Le Grusse est Enseignant Chercheur au CIHEAM-IAMM depuis 1991, Administrateur Scientifique du CIHEAM depuis 2005. Il a obtenu un Doctorat en Sciences de Gestion (1991) et est (i) diplômé de l’Institut d’Administration des Entreprises, (ii) titulaire d’un Master of Science en développement agricole et a obtenu une (iii) Maîtrise en Biologie des organismes et des populations avec une spécialisation en écologie numérique et modélisation. Il assure des activités d’enseignement, de recherche et de coopération et a créé et dirige un Master sur la « Gestion Agricole et l’Environnement ». Ces principaux enseignements se situent dans les domaines du conseil de gestion dans les entreprises agricoles et les territoires agricoles, les techniques de simulation, statistique et analyse des données, analyses typologiques, processus de négociation et de gestion collective, couplages de modèles bio-physiques et économiques, développement et animation de session de « jeux d’entreprise » sur la gestion de systèmes de production agricole au niveau régional et la gestion des ressources naturelles et des externalités. Ces dernières années ses travaux se sont orientés sur la gestion des externalités de la production agricole au niveau des territoires, plus spécifiquement sur la gestion des impacts des pesticides. Il est intervenant dans différentes Ecoles, Universités et Institutions : Faculté d’Agronomie de l’Université Libanaise Beyrouth, Institut Agronomique et Vétérinaire Hassan II (IAV) Rabat Maroc, Ecole des Mines d’Alès (France), CIHEAM- IAM Saragosse (Espagne). |
| terrains d’études |
France, Algérie, Tunisie, Maroc, Liban, Albanie, Mali, …et autres Pays Méditerranéens membres du CIHEAM |
| collaborations SCIENTIFIQUES |
|
| RECHERCHEs en cours |
|
| (co-)direction de thèses |
GRIMENE Chaima, Caractérisation spatiale de la vulnérabilité des ressources naturelles et gestion des risques de pollution diffuse liés aux pratiques phytosanitaires agricoles, Géographie et aménagement de l’espace, Université Paul Valéry Montpellier 3, TTSD Ecole doctorale 60 |
Jean-Paul BORD

Jean-Paul BORD
Membre permanent
| Fonction actuelle |
Professeur émérite Université Paul-Valéry Montpellier 3
|
| spécialité |
Cartographie
|
| responsabilités | |
| DOMAINES DE RECHERCHE ET D’EXPERTISE | |
| terrains d’études |
Méditerranée, Monde arabe, France |
| collaborations SCIENTIFIQUES | |
| RECHERCHEs en cours | |
| (co-)direction de thèses |
|
Marion LE TEXIER

Marion LE TEXIER
Membre permanent
|
marion.le-texier@univ-montp3.fr
|
|
| Fonction actuelle |
Maître de Conférences
|
| spécialité |
Sciences de l’information géographique, modélisation, mobilités et systèmes urbains
|
| responsabilités |
|
| DOMAINES DE RECHERCHE ET D’EXPERTISE | Spécialiste des sciences de l’information géographique et de la modélisation/simulation, mes recherches s’orientent autour d’un objectif unique : construire des bases comparatives solides pour éclairer la recherche et l’action publique. J’ai, en effet, toujours eu à cœur de rendre les protocoles d’analyse que je mobilise intelligibles au plus grand nombre, et d’en illustrer l’utilité en les appliquant à des cas d’études concrets, plus ou moins génériques. Au cours de ces dix dernières années, ceux-ci se sont progressivement resserrés autour de trois grandes thématiques : les facteurs de différenciation des pratiques individuelles de mobilité, les disparités d’accès aux aménités environnementales dans les espaces urbains et péri-urbains, et la communication médiatique sur les aléas et risques naturels. |
| terrains d’études | Europe, France métropolitaine, Mayotte |
| collaborations SCIENTIFIQUES |
|
| rECHERCHEs en cours |
|
| (co-)direction de thèses | HAVRET Marie : Mesurer les inégalités d’accès aux espaces verts urbains sur le temps long. Le cas de Rouen (1828-2018). Thèse débutée en septembre 2018 et financée par la region Normandie (RIN 100% Doctorants), en co-direction avec Sophie de Ruffray. |
Pascal CHEVALIER

MEMBRE PERMANENT
Membre permanent
| Fonction actuelle |
Professeur des universités
|
| spécialité |
Géographie rurale et développement local
|
| responsabilités |
Scientifiques, administratives, pédagogiques
|
| DOMAINES DE RECHERCHE ET D’EXPERTISE | Spécialiste de géographie rurale de l’Europe, Je m’intéresse particulièrement aux modalités de mise en œuvre de l’action publique locale (programmes européens de développement rural) et ses effets dans la dynamique du territoire. |
| terrains d’études | France, Europe centrale |
| collaborations SCIENTIFIQUES |
|
| RECHERCHEs en cours |
|
| (co-)direction de thèses |
|
Salah Eddine CHERRAD

MEMBRE PERMANENT
Membre permanent
| Fonction actuelle |
Professeur des Universités |
| spécialité |
Aménagement du Territoire – Aménagement Rural |
| responsabilités |
|
| DOMAINES DE RECHERCHE ET D’EXPERTISE |
|
| terrains d’études |
Constantinois – Algérie |
| collaborations SCIENTIFIQUES |
Université Paul Valéry, CREAD-Alger
|
| RECHERCHEs en cours | projet HTC — L’habitat et ses territoires dans le Constantinois : localisation, formes, évolution et acteurs. |
| (co-)direction de thèses |
|
Matthieu PÉROCHE

MEMBRE PERMANENT
Membre permanent
| Fonction actuelle |
Maître de conférences
|
| spécialité |
Géographie – Gestion des risques naturels et analyse spatiale
|
| responsabilités |
|
| DOMAINES DE RECHERCHE ET D’EXPERTISE |
Gestion des risques et des crises : contribution à la planification de gestion crise – retour d’expérience – diagnostic territorial – conception et conduite d’exercices cadres Acquisition, traitement et représentation de l’information géographique : conception de supports et d’outils pour la diffusion d’informations géographiques – calculs d’accessibilité territoriale – photogrammétrie par drone |
| terrains d’études |
Caraïbes, Mayotte, Maroc, Méditerranée, France métropolitaine |
| collaborations SCIENTIFIQUES |
|
| RECHERCHEs en cours |
|
| (co-)direction de thèses |
|
Christophe EVRARD

MEMBRE PERMANENT
Membre permanent
| Fonction actuelle |
Maître de Conférences, Département de Géographie-UPVM3 Directeur du cabinet d’études GéoSanté |
| spécialité |
Géographie de la Santé, Outils d’enquêtes, Statistiques
|
| responsabilités |
|
| DOMAINES DE RECHERCHE ET D’EXPERTISE | Démographie Médicale ; Risques Sanitaires ; Inégalités Sociales et Territoriales de Santé ; Diagnostic Territorial de Santé |
| terrains d’études |
France, DOM (Mayotte), Afrique (Sénégal, République Démocratique du Congo, Madagascar), Maghreb (Maroc) |
| collaborations SCIENTIFIQUES |
|
| RECHERCHEs en cours | Reconstruction historique de données de démographie médicale |
| (co-)direction de thèses |
Co-direction de thèse : AUGEROT Alix : La santé mentale des adolescents et jeunes adultes : approche territoriale des parcours de prise en charge sur le territoire Ouest Hérault |
Olivier BOUHET

MEMBRE PERMANENT
Membre permanent
| Fonction actuelle |
Maître de Conférences |
| spécialité | |
| responsabilités |
Transport, Mobilités, Réseaux, Géomatique Enseignant chercheur en géographique des transports, je m’intéresse particulièrement aux mobilités en zones urbaines, aux systèmes de transport en site propre pour l’effet réseau qu’ils génèrent. Le travail de thèse sur le tram-train à travers l’élaboration d’une méthode d’analyse multicritère (AHP) pour l’implantation de ce système venait également souligner les implications de ce mode dans l’évolution des pratiques notamment dans les pratiques multimodales. Plus récemment je me suis intéressé aux pratiques liées au co-voiturage afin d’en étudier les motivations, les raisons et l’association avec les autres modes |
| DOMAINES DE RECHERCHE ET D’EXPERTISE | |
| terrains d’études |
France |
| collaborations SCIENTIFIQUES | |
| RECHERCHEs en cours | |
| (co-)direction de thèses |
Marc DEDEIRE

Marc DEDEIRE
Membre permanent
| Fonction actuelle |
Professeur des Universités
|
| spécialité |
Aménagement des espaces ruraux, développement local, qualification territoriale
|
| responsabilités |
|
| DOMAINES DE RECHERCHE ET D’EXPERTISE | Marc Dedeire est professeur à l’Université Paul Valéry Montpellier 3, en aménagement de l’espace (Section 24 CNU). Ses recherches portent sur les processus de transformations des espaces ruraux à travers notamment les mutations démographiques et économiques. Il développement une analyse des formes de qualifications territoriales, et des trajectoires des espaces ruraux, en France et sur d’autres terrains, en Lituanie, en Hongrie. Les analyses aboutissement à concevoir des nouveaux outils de politiques publiques et d’actions locales par l’enjeu de l’aménagement qualitatif de l’espace. |
| terrains d’études |
France, Lituanie, Hongrie |
| collaborations SCIENTIFIQUES |
|
| RECHERCHEs en cours |
|
| (co-)direction de thèses |
|
JC GAILLARD

JC GAILLARD
Membre permanent
| Fonction actuelle |
Professor of Geography
|
| spécialité |
Études des catastrophes
|
| responsabilités | |
| DOMAINES DE RECHERCHE ET D’EXPERTISE | JC Gaillard is Professor of Geography at the University of Auckland. His work focuses on power and inclusion in disaster. It includes developing participatory tools for engaging minority groups in disaster risk reduction with an emphasis on ethnic and gender minorities, prisoners, children and homeless people. More details from: https://jcgaillard.wordpress.com. |
| terrains d’études |
Philippines |
| collaborations SCIENTIFIQUES | |
| RECHERCHEs en cours |
|
| (co-)direction de thèses |
|
Sylvain PIOCH
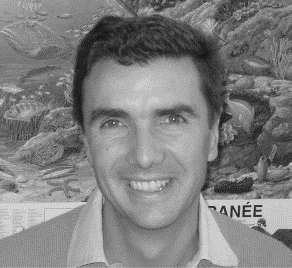
Sylvain PIOCH
Membre permanent
.
| Fonction actuelle |
MCF – HDR
|
| spécialité |
Aménagement des territoires, Géographie
|
| responsabilités |
Scientifiques :
Administratives :
Pédagogiques :
|
| DOMAINES DE RECHERCHE ET D’EXPERTISE |
Sylvain Pioch, est docteur (2008), Habilité à Diriger des Recherches (2017) qualifiées en géographie (sec. 23) et aménagement de l’espace (sec. 24) ainsi qu’ingénieur écologue (AFIE). Ses travaux de thèses, réalisés en partie au Japon (TUMSTA), portent sur la restauration des habitats marins exploités à l’aide de récifs artificiels et d’approches de gestion intégrée des zones côtières pro-actives. Il a poursuivi ses recherches en Floride dans le cadre d’un post-doctorat à la NOVA University, puis à l’UMR AMURE de l’Ifremer Brest, au sujet des techniques d’ingénierie écologiques côtières et des outils de dimensionnement des mesures compensatoires selon le concept de « no net loss » (Pas de Perte Nette) au sein de la séquence Eviter Réduire et Compenser. Il développe ses travaux sur les instruments et la gouvernance de compensation des impacts anthropiques : banques de compensation côtières, méthodes de calcul des gains et pertes de biodiversité et les techniques de restauration écologique marine. Il travaille actuellement sur les problématiques d’évaluation de la compensation des impacts anthropiques, la réglementation environnementale liée aux aménagements (lois, cadres opérationnels, processus transactionnels), les techniques d’ingénierie écologique (transplants, bouturage, substrats…) et les approches d’aménagement bio-inspirés, NBS ou d’eco-conception des infrastructures maritimes (design, matériaux, habitats artificiels). La co-construciton des projets d’aménagement avec les citoyens, à partir d’outils hybrides mêlant présentiel et numérique (interface « e-debat.fr ») complètent ses dispositifs de recherche en géo-aménagement pour mieux intégrer l’environnement au projet d’aménager la mer. Après 10 ans d’ingénierie en tant que chef de projet environnement, en France et à l’international, il est depuis 2011 maitre de conférence à l’université Montpellier 3 où il enseigne la géographie de l’environnement, l’aménagement des territoires sous l’angle de l’ingénierie territoriale environnementale et l’organisation des socio-écosystèmes littoraux. Il enseigne également à l’ENTPE au CNFPT, à l’Université de Corte (etc.) et à l’étranger à la NOVA University, ou en tant que conseillé de l’académie des énergies renouvelables marines du Japon.
Sylvain Pioch is currently a researcher at LAGAM laboratory as associate professor at University Paul-Valéry Montpellier in environmental/urban planning, dedicated to marine and coastal area. After a PhD in coastal geography partly done in TUMSAT (Japan), he continued as a post-doctoral fellow at Nova University (Florida, USA), and IFREMER (France) working on environmental planning, ecological engineering and scoring methods to value gains and losses of ecological functions. He works on issues linked to the mitigation of anthropogenic impacts, green infrastructure (harbor & maritime infrastructures, eco-designed, eco-friendly materials, artificial habitats), governance of mitigation in France and the US (laws & rules, guideline and ref. frameworks, transactional processes) and ecological engineering tools. His last research are focuses on hybrid citizen participatory tools (“e-debat”), in the aim to enhance environmental concerns in land planning. He teaches Graduate students at University Paul-Valéry Montpellier, Nova University (Florida) and in 6 other different training programs (ENTPE, school of civil engineering…) |
| terrains d’études | Zones littorales et côtières France métropolitaine et d’outre-mer (Guadeloupe, Martinique, Saint-Martin, Réunion, Mayotte, Nouvelle Calédonie et Polynésie française), Etats Unis (Floride, Caroline du Nord), Caraïbes (Haïti, Barbade), milieux coralliens (Australie, Indonésie, Fidji, Philippines…) et le Japon. |
| collaborations SCIENTIFIQUES |
|
| RECHERCHEs en cours | AATRE (Agora de l’Aménagement des Territoires Résilients), CONAQUAT (connectivité des milieux aquatiques), MERCi-Cor (Méthode pour Eviter Réduire et Compenser les impacts en milieu corallien) |
| (co-)direction de thèses |
En Post Doc / Ingénieurs
|
Adrien LAMMOGLIA

Adrien LAMMOGLIA
Membre permanent
| Fonction actuelle |
Maître de conférences
|
| spécialité |
Transports ; Mobilités ; Géosimulation ; Afrique
|
| responsabilités |
Membre du comité de rédaction / relecteur des revues :
|
| DOMAINES DE RECHERCHE ET D’EXPERTISE | Docteur en géographie et informatique, je suis spécialiste des problématiques de transport et mobilité. Plus spécifiquement, je travaille sur les transports flexibles et innovants comme les Transports A la Demande et les nouveaux systèmes de transports autonomes et connectés, mais aussi sur les mobilités actives et électriques. D’un point de vue méthodologique, je mobilise les outils de géosimulation (Systèmes Multi-Agents, Systèmes d’Information Géographique…) ainsi que les techniques d’enquête. Enfin, depuis 2010 je suis spécialisé dans la coopération France-Afrique, notamment sur les questions de développement des métropoles africaines. |
| terrains d’études | France, Sénégal, Cote d’Ivoire, Mali, Algérie |
| collaborations SCIENTIFIQUES |
|
| RECHERCHEs en cours |
ANR RA Velotactique 2020 – 2021, De l’urbanisme tactique cyclable au changement durable : une comparaison internationale des politiques publiques et des pratiques en contexte de pandémie. Défi Clé Région Occitanie « Mobilité intelligente et durable » 2021 – 2026. Occitanie : Premier terrain d’innovations et d’expérimentations en simulation et en réel de la mobilité intelligente et durable sur terre, mer et ciel.
|
| (co-)direction de thèses |
|
Jean-Philippe CHEREL

Jean-Philippe CHEREL
Membre permanent
| Fonction actuelle |
Ingénieur de recherche en sciences de l’information géographique
|
| spécialité |
Cartographie / SIG / traitement d’images
|
| responsabilités |
|
| DOMAINES DE RECHERCHE ET D’EXPERTISE |
Géographe de formation, titulaire d’une thèse de doctorat sur l’utilisation de l’imagerie satellitaire à haute résolution dans le suivi de l’urbanisation en Afrique, j’ai 22 années d’expériences en traitement d’images, SIG et cartographie au sein des différentes équipes de recherche de l’université Paul Valéry de Montpellier auxquelles j’ai été rattaché (UMR ESPACE, GESTER, UMR GRED, LAGAM). Je collabore à de nombreux projets scientifiques, en France comme à l’étranger. Je suis également impliqué dans la formation et le suivi d’étudiants de master et de doctorat, comme responsable de modules de cours en SIG et traitement d’images dans plusieurs universités ou organisme (Université Paul Valéry, Université de Nîmes, Université de Djibouti, IFAO) |
| terrains d’études |
France, Antilles, Maroc, Mali, Sénégal, Tanzanie, Djibouti |
| collaborations SCIENTIFIQUES |
|
| RECHERCHEs en cours |
|
| (co-)direction de thèses |
|
Membres associés
Elda MUCO

Elda MUCO
Membre associé
| Fonction actuelle |
Chercheure post-doctorat (Post)Authoritarian Landscapes Research Center (PAScapes), Université de Vilnius, Lituanie |
| DOMAINES DE RECHERCHES ET D’EXPERTISE |
Domaines de recherche : Développement territorial et rural ; capital territorial ; capital social ;
Expertise : Zones rurales et de montagne ; Gestion du territoire ; Gestion des ressources naturelles ; Coopération et action collective |
| terrains d’études |
Albanie Europe Central et de l’Est (PECO) |
| collaborations |
– Laboratoire de Géographie et d’Aménagement de Montpellier (LAGAM) – Université Paul Valery , Montpellier, France – CIHEAM – IAMM, Montpellier, France |
KOSIANSKI Jean-Michel

KOSIANSKI Jean-Michel
Membre associé
| Jean-michel.kosianski@univ-montp3.fr | |
| Fonction actuelle | Maître de Conférences Associé et Consultant
Université Paul Valéry Montpellier 3 |
| DOMAINES DE RECHERCHES ET D’EXPERTISE | Jean-Michel Kosianski est maître de conférences associé à l’Université Paul Valéry Montpellier 3 et consultant spécialisé dans le développement local par les métiers d’art. Il est Docteur en sciences économiques (Université de Montpellier, thèse sur le mécénat culturel). Ses travaux de recherche relèvent de l’économie territoriale et de l’économie de la culture ; ils portent principalement sur le développement local, les pôles métiers d’art, l’économie des métiers d’art, le lien entre la culture et le territoire. |
| terrains d’études | France |
| collaborations | Association Ville et Métiers d’Art
Union Provençale |
Émilie LAGAHÉ

Émilie LAGAHÉ
Membre associé
| – emilie.lagahe@univ-montp3.fr | |
| Fonction actuelle | – Ingénieure d’études en sciences de l’information géographique |
| DOMAINES DE RECHERCHES ET D’EXPERTISE |
Spécialité : Géographie – Risques naturels – Cartographie – Analyse spatiale – Valorisation de la recherche Responsabilités :
|
| terrains d’études | Caraïbes, Mayotte, Méditerranée, France Métropolitaine |
| collaborations |
Fahad IDAROUSSI

Fahad IDAROUSSI
Membre associé
| Fonction actuelle |
|
|
| DOMAINES DE RECHERCHES ET D’EXPERTISE |
Risque, vulnérabilité, réduction des risques de vulnérabilité, gestion des risques et crises, catastrophe, résilience, migration, exil Docteur en géographie et actuellement enseignant contractuel dans un lycée professionnel, mes travaux de recherche s’intéresse aux causes profondes de la vulnérabilité des migrants comoriens séjournant, de manière légale ou illégale à Mayotte, en allant au-delà des simples facteurs d’exposition aux aléas naturels (la vulnérabilité physique et matérielle), et en intégrant un point de vue historique, social, économique, politique et culturel. Mes travaux de recherche, interroge aussi l’efficacité des dispositifs institutionnels de gestion des risques et des crises, conçus en France métropolitaine et plaqués sur un territoire en développement aux spécificités bien différentes de celles des autres territoires français, en termes de développement local, de logiques territoriales d’appropriation de l’espace, de droits d’accès aux ressources et de pratiques et stratégies d’adaptation. A doctorate in geography and currently a contractual teacher in a vocational high school, my research focuses on the root causes of the vulnerability of Comorian migrants living legally or illegally in Mayotte, going beyond the simple factors of exposure to natural hazards (physical and material vulnerability), and integrating a historical, social, economic, political and cultural perspective. My research work also questions the effectiveness of institutional risk and crisis management systems designed in metropolitan France and applied to a developing territory with specificities that are very different from those of other French territories, in terms of local development, territorial logics of space appropriation, rights of access to resources and adaptation practices and strategies. |
|
| terrains d’études | Mayotte, océan Indien | |
| collaborations | Préfecture de Mayotte |
Dominique GANIBENC

Dominique GANIBENC
Membre associé
| dominique.ganibenc@yahoo.fr | |
| Fonction actuelle | Docteur en Histoire de l’art contemporain |
| DOMAINES DE RECHERCHES ET D’EXPERTISE |
Architecture, urbanisme, patrimoine industriel, patrimoine rural, paysage viticole, littoral, ville, campagne, vigne, vin
Ses travaux portent sur l’étude et la valorisation du patrimoine vitivinicole français. Il s’intéresse également à l’évolution de l’architecture et de l’urbanisme balnéaire en particulier dans l’Hérault. Après avoir travaillé pour différents organismes publics spécialisés dans la conservation du patrimoine, il a collaboré à plusieurs programmes de recherche dont celui portant sur le Sud Biterrois financé par la Fondation de France (2016-2019). Fondation pour laquelle il a coorganisé le colloque « La Mer monte. Quel littoral pour demain ? » (31 mai – 2 juin 2018) à Agde. Il intervient actuellement dans l’UE 6 « Littoral en projets. Aménagement et avenir des zones côtières » du Master PROJET (Projets d’aménagements et prospective territoriale). |
| terrains d’études | Occitanie, Aquitaine, Méditerranée |
| collaborations | Alexandre Brun, MCF-HDR |
Agnès MECHIN

Agnès MECHIN
Membre associé
| agnesmechin@hotmail.com | ||
| Fonction actuelle |
|
|
| DOMAINES DE RECHERCHES ET D’EXPERTISE |
Aménagement du territoire, Séquence Eviter – Réduire – Compenser, Dimensionnement de la compensation écologique, opérationnalité des outils basés sur des connaissances scientifiques, ergonomie Actuellement chef de projet dans le bureau d’études naturaliste ECO-MED, mobilisée sur des sujets de R&D relatifs à l’application pratique de la séquence ERC. Doctorat de géographie obtenu en 2020 («Dimensionner les mesures de compensation écologique : des outils opérationnels pour une meilleure appropriation par les acteurs de l’aménagement du territoire ») après 15 ans de parcours professionnel en tant qu’ingénieur agronome dans la région de Montpellier |
|
| terrains d’études | Occitanie, outre-mer | |
| collaborations | CEFE, Montpellier |
Noômène FEHRI

Noômène FEHRI
Membre associé
| fehri_n@yahoo.fr | |
| Fonction actuelle |
Fonction Enseignant-chercheur/ Maître de conférences HDR Organisme de rattachement Université de la Manouba -Faculté des Lettres, des Arts et des Humanité (Tunisie). |
| DOMAINES DE RECHERCHES ET D’EXPERTISE |
Mots clés : Géomorphologie, Hydrogéomorphologie, Risques Naturels, Géoarchéologie, Paléo-environnements, SIG, Cartographie. Biographie : Géographe de formation. Titulaire du DEA en « Systèmes Spatiaux et Environnement » (1999, ULP de Strasbourg). Docteur en géographie (2004, Université de Provence). Habilité à diriger des Recherches depuis 2017 (Université de Tunis I). Enseignant-chercheur (actuellement Maître de conférences HDR) au département de géographie de la Faculté des Lettres, des Arts et des Humanités de la Manouba depuis 2004. Membre du laboratoire de recherche « Biogéographie, Climatologie Appliquée et Dynamiques Environnementales ». Auteur/coauteur de plusieurs articles scientifiques sur l’érosion hydrique et éolienne et sur le risque inondations en Tunisie. Il a par ailleurs participé à des travaux en géoarchéologie et sur les paléoenvironnements dans différentes régions de la Tunisie. |
| terrains d’études | Le Nord, le Centre et le Sud Tunisiens |
| collaborations |
– Muséum National d’Histoire Naturelle, Paris, France. – Institut de Paléontologie Humaine, Paris, France. – Faculté Poly-disciplinaire de Safi (Université Cadi Ayyad), Safi, Maroc. – Faculté des Lettres et des Sciences Humaines Saïs-Fés, Maroc. |
Laurent BOISSIER

Laurent BOISSIER
Membre associé
| laurentboissier@free.fr | ||
| Fonction actuelle |
|
|
| DOMAINES DE RECHERCHES ET D’EXPERTISE |
Assurance, risques naturels, grêle, retrait gonflement des argiles, victimes, inondations Par mon cursus de géographe, je suis spécialisé depuis plus de 20 ans dans la gestion/prévention des risques naturels. Mon domaine de compétence, dans un premier temps centré sur les risques en zone méditerranéenne, fortement exposée à des phénomènes particuliers (épisodes cévenols) s’étend également à l’ensembles des risques à l’échelle mondiale (inondations lentes, submersions marines, sécheresse, sismicité, feux de forêts, cyclones…). |
|
| terrains d’études |
|
|
| collaborations |
LAGAM, Montpellier BRGM- Orléans |
Jake Rom CADAG

Jake Rom CADAG
Membre associé
| jdcadag@up.edu.ph | ||
| Fonction actuelle |
|
|
| DOMAINES DE RECHERCHES ET D’EXPERTISE | Catastrophes, réduction des risques de catastrophe, cartographie participative | |
| terrains d’études |
|
|
| collaborations |
|
Thomas Candela

CANDELA Thomas
Membre associé
|
|
|
| Fonction actuelle |
Responsable du pôle Recherche & Développement Société RisCrises |
| DOMAINES DE RECHERCHES ET D’EXPERTISE |
Géographie des risques, gestion de crise, cartographie, analyse spatiale, SIG, sémiologie graphique Mes travaux de recherche sont alimentés par ma formation de géographe des risques et mes recherches doctorales portées sur l’usage de la cartographie dans ce domaine. J’ai accompagné plusieurs missions de terrain dans le cadre de projets tels que l’ANR TIREX, Escape Volcano, le suivi de la crise volcanique de la Palma afin d’anticiper, estimer, analyser les conséquences des catastrophes naturelles et participer au retour d’expériences scientifiques. Intégré dans une structure privée en tant que responsable du pôle R&D, je transfère les enseignements de la recherche dans le développement de solutions cartographiques interactives dédiées au domaine des risques.
En parallèle, j’exerce des activités d’enseignement en tant que chargé de cours de l’Université Paul-Valéry, Montpellier 3 pour la cartographie et la sémiologie graphique sous SIG appliquées au domaine des risques. J’ai également une forte affinité avec le monde de la photographie, de la vidéo et du graphisme. Des compétences que j’entretiens depuis une dizaine d’années et que je mets au service de la recherche afin de communiquer et vulgariser sur les connaissances scientifiques acquises in situ. J’ai ainsi réalisé plusieurs courts métrages vidéo pour le compte du LAGAM et son unité de chercheurs dans les risques naturels (membres de la Geodisasters Research Team) |
| terrains d’études | France, International |
| collaborations | Laboratoire de Géographie et d’Aménagement de Montpellier (LAGAM) – Université Paul Valéry, Montpellier 3, Montpellier – France. |
Annabelle Moatty

Annabelle Moatty
Membre associé
| amoatty@yahoo.fr | |
| Fonction actuelle | Chercheure contractuelle (post-doctorante) à l’INRAE |
| DOMAINES DE RECHERCHES ET D’EXPERTISE | Risques « naturels », Reconstruction post-catastrophe, Vulnérabilités, Capacités d’adaptation, Réduction des Risques de Catastrophe (RRC / DRR), Trajectoires de développement et d’adaptation
Annabelle Moatty est Géographe, spécialisée en gestion des risques et des reconstructions post-catastrophe liées à la survenue d’aléas naturels. Sa thèse intitulée « Pour une Géographie des reconstructions post-catastrophe : risques, sociétés et territoires », est ancrée dans les sciences humaines et sociales. C’est au cours de ces années de doctorat qu’elle développe une méthode originale d’analyse rétrospective (aussi appelée retour d’expérience) de la post-catastrophe qu’elle a adaptée en France (Ile-de-France, Aude, Var, Val de Sambre, Antilles – Saint-Martin, Bouches-du-Rhône), en Indonésie (provinces de Klaten, Sleman et Yogyakarta) et au Japon (province d’Iwate). Sa recherche questionne les concepts d’adaptation, de résilience et de vulnérabilités à différentes échelles dans le contexte de l’injonction au « Build Back Better » de la reconstruction post-catastrophe. Dans l’objectif de contribuer au développement d’outils d’aide à la décision, elle élabore actuellement un dispositif collaboratif, qui croise le jeu sérieux et la simulation multi-agents, destiné à la co-construction de projets de gestion des inondations intégrant les Solutions fondées sur la Nature. |
| terrains d’études | France (métropolitaine et Outre-mer) – Indonésie – Japon |
| collaborations |
Jean-Marie BALLOUT

Jean-Marie BALLOUT
Membre associé
| Fonction actuelle |
Professeur d’Histoire-Géographie-Géopolitique-Sciences politiques Lycée polyvalent Kaweni, Mayotte, France |
| DOMAINES DE RECHERCHES ET D’EXPERTISE |
Géopolitique de l’aménagement ; urbanisme de projet ; planification territoriale ; développement ; Suds ; action publique territoriale ; gouvernance ; services essentiels ; inégalités socio-spatiales ; fragmentation ; ségrégation ; politiques urbaines/d’aménagement du territoire ; conflits d’acteurs ; comparatisme ; insularité ; gestion des déchets ; conservation de la nature ; eau.
Docteur en géographie et aménagement du territoire, enseignant-chercheur universitaire durant une dizaine d’années, je suis actuellement professeur d’Histoire-Géographie au LPO de Kaweni à Mayotte. Mes recherches portent sur les processus de (re)territorialisation induits par les politiques publiques d’aménagement du territoire et d’urbanisme. Il s’agit de saisir les systèmes d’action à l’oeuvre, les conflits d’acteurs qui leurs sont inhérents et les modalités de régulation mises en place. En outre, il est question de caractériser les productions territoriales générées : en particulier à travers les rapports entre les processus de marginalisation produits par les acteurs urbains dominants de l’aménagement des villes, leurs politiques de traitement des marges urbaines et les stratégies d’intégration urbaine et de résistance des populations (Maroc, Algérie, France). Par ailleurs, mes travaux portent sur l’habiter dans les milieux réputés difficiles des pays dits du Sud. L’objectif est de mettre en évidence les mutations socio-spatiales contemporaines en cours dans ce type spécifique de contextes territoriaux à l’aune des politiques de développement qui y sont déployées (Haut-Atlas occidental, Maroc). Enfin, j’élargis mon analyse géographique autour de problématiques liées à l’environnement : gestion des déchets, accès à l’eau et conservation de la nature (gestion des forêts) dans les territoires insulaires et tropicaux de l’océan Indien (Mayotte, Réunion, Comores, Seychelles, Maurice). |
| terrains d’études |
|
| collaborations |
|
| PUBLICATIONS |
|
Luigi BELLINO

Luigi BELLINO
Membre associé
| Fonction actuelle |
Fonctionnaire, Région des Pouilles |
| DOMAINES DE RECHERCHES ET D’EXPERTISE |
Réformes administratives en Italie, gouvernance et planification stratégiques dans les villes métropolitaines, sécurité urbaine. |
| terrains d’études | Italie |
| collaborations | |
| PUBLICATIONS |
|
François-Nicolas ROBINNE

François-Nicolas ROBINNE
Membre associé
| francois.robinne@canada.ca | |
| Fonction actuelle | Chercheur scientifique, feux de forêt
Ressources naturelles Canada / Gouvernement du Canada |
| DOMAINES DE RECHERCHES ET D’EXPERTISE | Incendies de forêts, hydrologie, sécurité de l’eau, analyse et modélisation spatiale.
Je travaille depuis plusieurs années sur les risques que les incendies de forêts font peser sur la sécurité de l’eau à travers le monde, au Canada en particulier. Les problèmes de qualité et de disponibilité en eau à la suite de grands incendies peuvent en effet occasionner des problèmes de production d’eau potable, ainsi que des problèmes pour la conservation des écosystèmes aquatiques. Mon travail s’inscrit dans la gestion des risques émergents et systémiques, et se focalise en grande partie sur le développement d’informations de base pour la compréhension et la gestion du risque dans un contexte de changement global. J’ai également à cœur la communication autour des solutions basées sur la nature, en particulier la façon dont l’utilisation raisonnée du feu et la restauration forestière peuvent protéger les bassins versants contre des feux catastrophiques. |
| terrains d’études | Canada |
| collaborations | – University of Alberta, Edmonton, AB, Canada
– Oregon State University, OR, USA – International Union of Forest Research Organizations |
| PUBLICATIONS | Lien ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0554-7668 |
Emna Genty Jedidi

Emna Genty Jedidi
Membre associé
| emna.jedidi@gmail.com | ||
| Fonction actuelle |
|
|
| DOMAINES DE RECHERCHES ET D’EXPERTISE |
– Gouvernance urbaine – Projet urbain – Développement Durable Docteur en aménagement de l’espace à l’Université Paul Valéry Montpelier III en 2017, diplômée d’un Master Erasmus Mundus EURMed de l’Université d’Aix Marseille en 2010 et de formation en architecture, urbanisme et aménagement de l’université de Carthage. Je suis Lauréate du Programme Atlas de la FMSH et UMRLADYSS (postdoc) sur la démocratie participative. Enseignante universitaire titulaire en détachement de l’université de Carthage. Pendant 5 ans, j’ai assuré des TDs, cours et ateliers niveau licence sur le développement urbain, les projets urbains et les outils d’aménagement. J’ai encadré des mémoires de fin d’études et membre de jury de soutenances des mémoires (mobilité douce, valorisation urbaine, programmation immobilière,…). J’ai aussi été enseignante invitée à l’université Paul Valéry dans le cadre du Programme de recherche et d’enseignement en mobilité avec l’axe 2 (Gouvernance des ressources et des territoires) UMR GRED. J’ai intégré des collectivités teritoriales à l’étranger et en région Ile-de-France (SEM, collectivités locales,…) sur des projets urbains (PPP, NPNRU,…), d’aménagement (ZAC, PUP,…) et de planification urbaine (PLU, PLUi, ADS,…). J’encadre aussi des étudiants en alternance niveau master dans l’objectif de recherche-action. En parallèle, j’exerce en tant que consultante-conseillère en développement territorial. |
|
| terrains d’études | Méditerranée, France | |
| collaborations |
– Université de Carthage- Tunisie : enseignante universitaire en détachement – Lauréat du Programme Atlas du postdoctorat financé par FMSH-UNIMED et accueillie par UMR Ladyss « Les projets urbains et la démocratie participative : Expériences et outils »-ILE DE FRANCE – GERAD- DAKAR |
|
| PUBLICATIONS | https://cv.archives-ouvertes.fr/emna-genty-jedidi |
Ali El Samad

Ali El Samad
Membre associé
| Fonction actuelle |
Directeur Général du Ministère de la Culture (Liban) Professeur de Géographie à l’Université Libanaise |
| DOMAINES DE RECHERCHES ET D’EXPERTISE |
Géographie politique, Géopolitique |
| terrains d’études |
Liban Monde Arabe |
| collaborations | |
| PUBLICATIONS |
Fadila Kettaf

Fadila Kettaf
Membre associé
| fkettaf@yahoo.fr | ||
| Fonction actuelle | MCF HDR au Département d’architecture, Université des sciences et de la technologie d’Oran (USTO-MB) | |
| DOMAINES DE RECHERCHES ET D’EXPERTISE |
|
|
| terrains d’études | Algérie, France | |
| collaborations |
LAGAM SAH (Society of Architectural Historians) |
|
| PUBLICATIONS |
Lien Hal: https://hal.archives-ouvertes.fr/tel-01084752/ Lien Google Scholar : https://scholar.google.com/scholar?hl=fr&as_sdt=0%2C5&q=fadila+kettaf&oq=fadila+ketta Lien Isidore : https://isidore.science/a/kettaf_fadila |
Karl Hoarau

Karl Hoarau
Membre associé
| karl.hoarau@cyu.fr | |
| Fonction actuelle | Maître de conférences en géographie au laboratoire M.R.T.E., Cergy Paris Université |
| DOMAINES DE RECHERCHES ET D’EXPERTISE |
Mots clés : Cyclones tropicaux extrêmes – Modes de variabilité de l’activité cyclonique – Cyclones et changement climatique – Risques cycloniques Karl Hoarau est maître de conférences au département de Géographie de l’Université de Cergy Paris. Il a été directeur de département (2009-2012), responsable d’un parcours de Master (2006-2010), « Territoires et Acteurs du Risque, Analyses Comparées (TARAC) », et élu au Conseil Scientifique de l’Université de Cergy-Pontoise (2008-2012). Ses recherches portent sur l’analyse de l’intensité des cyclones tropicaux à partir de l’imagerie satellitaire dont l’archivage est continu depuis le début des années 1980. Cette homogénéisation des données facilite la comparaison de l’intensité des cyclones, par bassin océanique et à l’échelle du globe. Ses travaux concernent aussi les modes de variabilité de l’activité des cyclones tropicaux (les influences d’El Niño ou La Niña, du dipôle de l’Océan Indien, des oscillations décennales ou multi-décennales de la température des océans). Une meilleure compréhension de ces différents cycles permettrait aussi de préciser l’influence du changement climatique actuel sur l’activité des cyclones tropicaux extrêmes (catégories 4 et 5, vents à partir de 215 km/h ou 115 nœuds). Son vécu des cyclones (à La Réunion, aux Philippines, et en Floride) a enrichi ses connaissances des risques associés à ces aléas destructeurs. |
| terrains d’études | Les bassins cycloniques du globe (océans Pacifique, Indien, Atlantique), îles et littoraux associés |
| collaborations |
– Indian Institute of Tropical Meteorology, Pune, India – University of Guam (UOG), Marianas Islands, USA – National Weather Service, Guam, Marianas Islands, USA – PAGASA (Philippines Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration), Quezon City, Philippines |
| PUBLICATIONS | Lien Research Gate : https://www.researchgate.net/profile/Karl-Hoarau |
Julien ADI
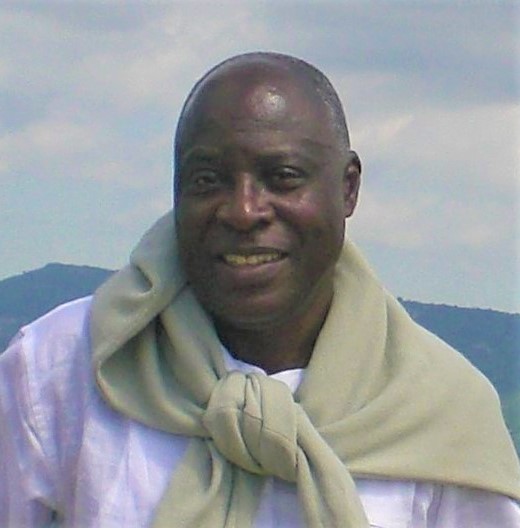
Julien ADI
Membre associé
| julien.adi@sudhemisphere.com | |
| Fonction actuelle |
Responsable de R & D & chargé de formation à Calemco Technico-commercial à Calvet Agrofournitures Gérant de SudHemisphère |
| DOMAINES DE RECHERCHES ET D’EXPERTISE |
Gestion & coordination de projets humanitaires (Eaux, assainissement & hygiène) Agro-alimentaire |
| terrains d’études | Afrique & Asie |
| collaborations | Professeur associé du Master en Ecologie des Maladies infectieuses, Aléas naturels et Gestion des Risques (ECOM-ALGER) depuis 2014 à nos jours : Principes d’élaboration & d’évaluation d’impacts de projets |
Khalid MEHDI

Khalid MEHDI
Membre associé
| k.mehdi@usms.ma | |
| Fonction actuelle | Doyen de la Faculté Polydisciplinaire de Khouribga |
| DOMAINES DE RECHERCHES ET D’EXPERTISE |
Mots-clés : Glissements de terrains, effondrement, érosion côtière, submersion marines Domaines de compétences :
|
| terrains d’études | Littoral Atlantique du Maroc |
| collaborations | UR LAGAM |
| PUBLICATIONS |
Lien Researchgate : https://www.researchgate.net/profile/Mehdi-Khalid Lien Google Scholar : https://scholar.google.fr/citations?user=FicqKgEAAAAJ&hl=fr |
Marianne DE OLIVEIRA

Marianne DE OLIVEIRA
Membre associé
| marianne.de-oliveira@univ-montp3.fr | ||
| Fonction actuelle |
|
|
| DOMAINES DE RECHERCHES ET D’EXPERTISE |
Mots-clés : Gestion des risques naturels et technologiques, jeux d’acteurs, gouvernance territoriale, planification, aménagement des territoires Compétences : – participation à la définition des politiques publiques environnementales et mise en œuvre de projets – mise en place et animation de réseaux d’acteurs économiques et des partenaires institutionnels – encadrement des agents, animation, suivi, supervision, évaluation – élaboration et suivi budgétaire – rédaction de documents stratégiques et documents opérationnels – suivi de l’activité des directions concernées par les projets – participation aux instances de direction et de décisions |
|
| terrains d’études |
|
|
| PUBLICations | https://www.meissonier.fr/cv/jury.php?noeud=jurys_theses&id=0 |
Loïc LE DE

Loïc LE DE
Membre associé
| Loic.le.de@aut.ac.nz | |
| Fonction actuelle |
Senior Lecturer, Faculty of Health and Environmental Sciences Coordinator of Master of Disaster Risk Management and Development Organisme de rattachement : Auckland University of Technology (AUT) |
| DOMAINES DE RECHERCHES ET D’EXPERTISE | Mon domaine de recherche inclut la réduction des risques de catastrophes, la participation pour le développement et laréduction des risques de catastrophes, les migrations et les aides des communautés transnationales en temps de catastrophe. Mon travail/recherche est porté sur la création du dialogue et renforcer la collaboration entre populations locales et organisations dont le rôle est la réduction des risques de catastrophes. Ces 10 dernières années, j’ai travaillé principalement dans le Pacifique, particulièrement au Samoa, Tonga, Vanuatu, Nouvelle Calédonie et Nouvelle Zélande. |
| terrains d’études | Région Pacifique |
| collaborations | |
| PUBLICATIONS | Lien Google Scholar : https://scholar.google.co.nz/citations?user=R3z4i8kAAAAJ&hl=en&oi=sra |
Driss ZEROILI

Driss ZEROILI
Membre associé
| Fonction actuelle |
Responsable data et géomatique à la Direction territoriale SNCF RESEAU Occitanie
|
| DOMAINES DE RECHERCHES ET D’EXPERTISE | Géographie – Géomatique – Data |
| terrains d’études | France |
| collaborations |
Direction territoriale SNCF RESEAU Occitanie (Montpellier – Toulouse – France) LAGAM |
| PUBLICATIONS | Driss Zeroili, 2014. Contribution de la cartographie et des Systèmes d’Information Géographique (S.I.G) à la gestion urbaine : cas de la ville de Mohammedia au Maroc. Thèse de géographie et aménagement de l’espace – Montpellier. 276 pages. |
Tahar KHARCHI

Tahar KHARCHI
Membre associé
| taharkharchi@gmail.com | |
| Fonction actuelle | Enseignement vacataire à l’université de Sétif 1 (Algérie) |
| DOMAINES DE RECHERCHES ET D’EXPERTISE | Mots clés : Géographie urbaine, Géographie de la mobilité et des transports, Analyse spatiale, SIG, SGBD
Tahar Kharchi enseigne à l’université de Sétif 1 les Systèmes d’Information Géographique, la géographie des transports, l’économie des transports pour le Master Economie et Gestion des Transports. Ses compétences en géomatique sont la cartographie, l’analyse spatiale, la gestion de bases de données géographiques; en informatique, il développe sous Java et Python, et maîtrise le langage UML. |
| terrains d’études | Montpellier et Sétif |
| collaborations | Université de Stéif 1 en Algérie |
| PUBLICATIONS | Kharchi (Tahar), 2021, Mobilité, transport et organisation de l’espace dans la métropole de Montpellier. Essai de modélisation par les données de téléphonie mobile et l’accessibilité des scolaires. Thèse de doctorat, Université Paul Valéry Montpellier 3, 368 pages.
Dominguès (Catherine) et Kharchi (Tahar), Map Classification according to their Visual Global Properties, 26th International Cartographic Conference, 25th-30th august 2013, Dresde (Allemagne), Publié dans les Actes de l’International Cartographic Association, 2013, 10 pages. Kharchi (Tahar), L’offre intermodale de transport de Montpellier : un exemple d’une ville française, Colloque international « Urbanisation et mobilité » (Paris 7 – Sétif 1), 18-19 octobre 2014 à Sétif, Communication avec actes (22 pages) À paraître : Kharchi (Tahar) et Miossec (Jean-Marie), La théorie des transports, Présentation et traduction de l’ouvrage de Cooley (Charles Horton) [1894], L’Harmattan, 140 pages (en préparation) |
Fernanda MOSCARELLI

Fernanda MOSCARELLI DA CRUZ
Membre associé
| fe_moscarelli@yahoo.com.br | |
| Fonction actuelle | Attachée Temporaire d’Enseignement et Recherche – ATER au département de Géographie et Aménagement, Université Paris Nanterre |
| DOMAINES DE RECHERCHES ET D’EXPERTISE |
Mots clés : Gouvernance, Environnement, Aménagement Urbain, interventions urbaines, placemaking méthodologies, participation citoyenne, quartiers précaires, risques d’inondation. Issue d’un parcours académique et professionnel dans le domaine de l’architecture et de l’urbanisme, je me suis graduellement intéressée à l’étude des représentations des acteurs et de l’organisation des réseaux de gouvernance, ainsi que de l’analyse des politiques territoriales de caractère environnemental, intersectoriel et transfrontière, faite au cours des Masters, du Doctorat et des deux Post-doctorats. Ces intérêts sont également présents dans mon parcours professionnel associant recherche et enseignement. Mon parcours recherche est riche et divers, présentant trois points d’adhérence. Initialement, mes recherches orbitent autour de trois grandes thématiques et à leur interface : (a) urbanisme et aménagement, (b) gouvernance, (c) participation citoyenne. Elles se caractérisent par multiples terrains de recherche, résultants de ma proximité pendant mes études ou ma carrière professionnelle, dont je souligne la région métropolitaine de Porto Alegre et les municipalités de Passo Fundo et Pelotas, au Brésil ; l’agglomération de Montpellier et la Région Urbaine de Grenoble en France. Plusieurs études comparatives ont été réalisées utilisant comme terrain la France et le Brésil, mais aussi l’Argentine, l’Uruguay et, très ponctuellement l’Italie. Ces études présentent aussi une forte vision multiscalaire, qui va du bâtiment et son environnement immédiat aux quartiers, villes, métropoles et régions. |
| terrains d’études | France, Brésil, études comparatifs France-Brésil, Brésil- Latino-Amérique |
| collaborations |
IMED Facultés Meridionales UniRitter Université Fédérale du Rio Grande do Sul |
| PUBLICATIONS |
Lien HAL : https://hal.archives-ouvertes.fr/search/index/?q=%2A&authFullName_s=Fernanda+da+Cruz+Moscarelli Lien Research Gate : D-3963-2016 Lien Google Scholar : https://scholar.google.com/citations?user=-3K4iiUAAAAJ&hl=en Lattes (Brésil) : http://lattes.cnpq.br/9914381304897211 |
Houda BAÏR

Houda BAÏR
Membre associé
| bair_houda@yahoo.com | |
| Fonction actuelle | Maître de Conférences en Histoire à l’université de Tunis |
| DOMAINES DE RECHERCHES ET D’EXPERTISE |
Mots clés : Histoire de la cartographie, histoire de la Tunisie, colonisation, aménagement du territoire Houda Baïr est maître de conférence en Histoire à l’Université de Tunis. Ses travaux portent principalement sur l’histoire de la cartographie au XIXe siècle, en particulier en Tunisie. Ils prennent en compte le rôle qu’ont joué les cartographes dans la connaissance du territoire, l’évolution de son organisation politique et administrative, la construction d’une identité nationale, l’hybridation du savoir scientifique et du savoir vernaculaire ainsi que l’amorce du processus de colonisation. En rapport avec l’histoire de la cartographie, H. Baïr traite également de l’émigration française en Tunisie, après l’instauration du Protectorat en 1881, notamment l’émigration agricole à la suite du passage d’une colonisation d’exploitation à une colonisation de peuplement. Dans une perspective interdisciplinaire, elle analyse aussi les enjeux du projet de la régionalisation ainsi que de la politique d’aménagement du territoire tunisien. |
| terrains d’études | Tunisie |
| collaborations | Membre du Laboratoire Diraset – études maghrébines,Faculté des sciences humaines et sociales de l’Université de Tunis |
| PUBLICATIONS | Lien sur HAL : https://cv.archives-ouvertes.fr/houda-bair |
Bouh OMAR ALI

Bouh OMAR ALI
Membre associé
| Fonction actuelle | Maître de conférences au Département de Géographie, Université de Djibouti |
| DOMAINES DE RECHERCHES ET D’EXPERTISE |
Mes travaux de recherche portent sur plusieurs thématiques qui ont émergé dans le cadre de ma recherche doctorale. Dans un premier temps, il s’agit d’entretenir et de mettre à jour régulièrement la base de données BDCanaca (Base de Données sur les Catastrophes naturelles dans la corne de l’Afrique) construite dans le cadre de ma thèse. L’analyse des informations de cette base de données montre une recrudescence des catastrophes naturelles au cours des dernières décennies dans la région de l’IGAD (Corne de l’Afrique). Les pays de la région sont marqués par une forte vulnérabilité qui s’explique par plusieurs facteurs qui sont d’ordre socio-économiques et politiques. Notre approche de recherche vise à comprendre la relation entre risque, catastrophe et développement. Il s’agit de saisir le rôle du développement dans l’explication des conséquences des catastrophes naturelles et du niveau de la vulnérabilité des communautés urbaines et rurales des pays de la région de l’IGAD. Ensuite, l’étude de la vulnérabilité des enjeux humains et économiques exposés au risque d’inondation a permis de développer une méthodologie d’évaluation de la vulnérabilité adaptée à des contextes marqués par des conditions de vie dégradées et des outils d’aide à la décision. Cette méthodologie qui se veut transposable pourrait-être appliquée dans d’autres villes de la région de l’IGAD qui sont très concernées par le risque inondation. Il s’agit des villes concentrant d’importants enjeux humains et économiques menacés par les inondations. Enfin, notre recherche propose à développer des outils d’aide à la décision qu’il faudra mettre à la disposition des autorités des villes étudiées. Nous poursuivons ainsi la réflexion qui a été développée dans le cadre de mes travaux de thèse permettant la conception des outils pour une meilleure gestion des crises en développant une méthode d’estimation des enjeux humains et économiques menacés par les inondations. Actuellement, mes travaux portent sur les impacts sanitaires et socio-économiques de la pandemie Covid 19 sur les communautés urbaines et rurales. Il s’agit d’évaluer les impacts de cette pandemie sur les moyens de subsistence des populations par le biais des missions de terrain en Somalie et en République de Djibouti. |
| terrains d’études |
– Région de l’IGAD (Afrique de l’Est) – République de Djibouti – Dire-Dawa (Éthiopie) – Somaliland |
| collaborations | |
| PUBLICATIONS | Lien HAL : https://cv.archives-ouvertes.fr/bouh-omar-ali |
Fabienne NOTARIO GAFSI

Fabienne NOTARIO GAFSI
Membre associé
| Fabienne.ng@yahoo.com | ||
| Fonction actuelle | Chercheuse rattachée / Enseignante à IDHES CNRS (UMR 8533) / IUT- Université d’Evry Val d’Essonne | |
| DOMAINES DE RECHERCHES ET D’EXPERTISE |
Mots clés : Géopolitique de l’eau, Risque, Adaptation, Environnement – Management environnemental – Gouvernance et territoire – Aménagement des territoires et développement durable des espaces urbains et ruraux (organisation territoriale française, enjeux, institutions et acteurs, …) – Gestion des risques et adaptation – Changement climatiques – Géopolitique et conflits autour de la ressource en eau – Géographie du tourisme et frontières – Géographie des échanges (flux matériels et immatériels, flux migratoires et frontières, les intégrations régionales, grandes infrastructures de transport et de plateformes intermodales, portuaires, aéroportuaires…) – Maîtrise des logiciels de cartographie – La prospective stratégique et l’analyse des jeux d’acteurs |
|
| terrains d’études |
|
|
| collaborations |
–IDHES CNRS (UMR 8533), Paris Saclay-Evry, France – Union internationale de la Presse Scientifique, Paris, France – Global Future College, Paris, France |
|
| PUBLICATIONS |
Lien HAL : https://cv.archives-ouvertes.fr/dr-fabienne-notario-gafsi Lien Researchgate : https://www.researchgate.net/profile/Fadia-Gafsi Global Future College http://www.global-future-college.org/fr/equipe-global-future-college/chercheurs-associes |
Moulay Abdelouahed OUFKIR

Moulay Abdelouahed OUFKIR
Membre associé
| oufkirmoulay@yahoo.fr | ||
| Fonction actuelle | Assistant socio-éducatif au Conseil Départemental de l’Hérault | |
| DOMAINES DE RECHERCHES ET D’EXPERTISE |
– Mutation du monde oasien – Espaces périphériques et frontaliers – Paysannerie et nomadisme |
|
| terrains d’études |
|
|
| collaborations | Université Mohammed V de Rabat Faculté des Lettres et des Sciences Humaines, Laboratoire « Ingénierie du Tourisme, Patrimoine et Développement durable des Territoire » (LITOPAD), Maroc | |
| PUBLICATIONS |
Moulay Abdelouahed Oufkir « Changements socio-économiques et recompositions territoriales dans le bassin du Guir (Sud(Est marocain) (Effets des politiques publiques et des initiatives individuelles et collectives) Résumé de thèse, Revue GéoDév.ma, Volume 8 (2020), en ligne : https://revues.imist.ma/index.php/GeoDev/article/view/22726/12124Moulay Abdelouahed Oufkir « Les territoires de l’outarde au Maroc : du nomade à la mondialisation via les émiratis » Revue GéoDév.ma, Volume double 6-7 (2018-2019), en ligne : https://revues.imist.ma/index.php/GeoDev/article/view/16417/9050 |
Oussama MGHRIBI

Oussama MGHIRBI
Membre associé
| oussama.mghirbi@gmail.com | ||
| Fonction actuelle |
|
|
| DOMAINES DE RECHERCHES ET D’EXPERTISE |
Domaine de recherche : Agronomie; Environnement; Agro-écologie; Gestion des ressources naturelles; Gestion agricole et territoires; Sciences humaines et sociales et sciences de l’environnement; Géographie et aménagement. Domaines d’expertise : Gestion des ressources naturelles et préservation des eaux et du sol. Gestion de la pollution diffuse liée aux pratiques phytosanitaires et développement d’indicateurs. Modélisation technico-économique et conception d’outils d’aide à la décision en agriculture/environnement. Agriculture de précision, Smart agriculture, Intelligence Territoriale. Cartographie des risques de la pollution diffuse d’origine agricole, aménagement territorial et SIG. |
|
| terrains d’études |
|
|
| collaborations |
– IAV Hassan II, Rabat, Maroc – IRD Mali, Bamako, Mali – Université Libanaise, Bierut, Liban – INRGREF, Tunis, Tunisie |
|
| PUBLICATIONS |
Lien HAL : https://cv.archives-ouvertes.fr/oussamamghirbi Lien Research Gate : https://www.researchgate.net/profile/Oussama_Mghirbi2 Lien Google Scholar : https://scholar.google.com/citations?user=c4mY2RAAAAAJ&hl=fr Autre : https://www.iamm.ciheam.org/ressources/opac_css/index.php?lvl=etagere_see&id=108 |
Stéphane LOUBIE

Stéphane LOUBIE
Membre associé
| stephane.loubie@gmail.com | |
| Fonction actuelle | Chef du service « Mobilité durable » au Département de l’Hérault |
| DOMAINES DE RECHERCHES ET D’EXPERTISE |
Mots clés : système de mobilité, mobilité durable, mobilités alternatives, aménagement rural et périurbain, gouvernance. Stéphane Loubié est responsable de la mobilité durable au sein d’une collectivité départementale. Ses compétences développées durant différentes expériences professionnelles tant dans le domaine privé (environnement littoral, milieux portuaires, filières maritimes) que public (aménagement, urbanisme, transports et mobilité), ainsi que la préparation d’une thèse sur la « Mobilité durable périurbaine » démontre son intérêt dans l’articulation des pratiques en aménagement du territoire. Il est par ailleurs intervenant universitaire en master 2 « Transport, mobilités et réseaux » de l’Université Paul-valéry de Montpellier 3. Il participe actuellement à différents travaux de recherche en cours de publication portant sur le covoiturage, le partage de voirie et la gouvernance des mobilités. |
| terrains d’études | Espace méditerranéen, zones rurales et périurbaines |
| collaborations |
2019 : Membre du comité d’organisation du colloque international « Les mobilités émergentes : nouvelles pratiques et conséquences socio-spatiales » des 10 et 11 Octobre 2019 organisé par l’Université Paul-Valéry de Montpellier 3. UMR GRED (Gouvernance, Risques, Environnement, Développement) UPVM3/IRD. 2012 : Membre du comité d’organisation du colloque international « L’intermodalité en questions : durabilité, accessibilité, mobilité » organisé les 6 et 7 juin 2012 par l’Université Paul-Valéry de Montpellier 3. UMR GRED (Gouvernance, Risques, Environnement, Développement) UPVM3/IRD |
| PUBLICATIONS | Lien HAL : https://cv.archives-ouvertes.fr/stephane-loubie |
Aziza GHRAM MESSEDI

Aziza GHRAM MESSEDI
Membre associé
| Fonction actuelle | Maitre assistant à l’université de Tunis. Faculté des sciences humaine et sociales de Tunis | |
| DOMAINES DE RECHERCHES ET D’EXPERTISE |
Mots clés : géomorphologie, risque de désertification, géotourisme, télédétection, SIG – Cartographie des paysages géomorphologiques et valorisation géotouristique – Etude de la dynamique des paysages géomorphologiques : Le risque de désertification en milieux arides : l’apport de la télédétection et le SIG dans l’étude de la dynamique des paysages morphologiques à différentes échelles de perception |
|
| terrains d’études | Sud Tunisien | |
| collaborations |
|
|
| PUBLICATIONS |
Lien HAL : https://aurehal.archives-ouvertes.fr/author/read/id/1592424 Lien Research Gate : https://www.researchgate.net/profile/Aziza_Messedi |
Doctorants
Manon BASSE

Manon BASSE
Doctorante
|
|
|
| titre de la thèse | Le transport autonome connecté semi-collectif (TAC-SC) : solution à la dépendance automobile et à l’autosolisme ? |
| terrains d’études | France métropolitaine |
| (co-)directeurs | Laurent Chapelon (LAGAM) & Lionel Brunel (EPSYLON) |
| ORIGINE DU financement | Université Paul-Valéry Montpellier 3 – Fédération MIDOC |
| résumé de la thèse | Les enjeux inhérents au changement climatique et à la qualité de l’air impliquent de faire évoluer les pratiques de mobilité vers une plus grande durabilité. En adaptant l’offre à la demande, le transport à la demande (TAD) s’est imposé ces dernières années comme une solution efficace de désenclavement des zones péri-urbaines et rurales et de réduction de la dépendance automobile. Or, les progrès récents dans le domaine des transports intelligents offrent de nouvelles perspectives d’innovation en rendant le TAD encore plus flexible, inclusif, durable et adapté aux besoins des usagers. Ainsi, ce projet de recherche porte sur les conditions de déploiement d’un transport autonome connecté semi-collectif (TAC-SC) à destination du public (2 à 15 passagers par tournée). Le TAC-SC suit la logique d’organisation des transports en commun qui consiste à favoriser le remplissage des véhicules par mutualisation des déplacements, tout en bénéficiant des avantages du véhicule autonome (service fonctionnant 24h/24, 7j/7 dans des conditions de sécurité optimisées). En l’état actuel, la conduite totalement autonome de véhicules individuels n’est pas pleinement opérationnelle et le cadre législatif nécessaire à son encadrement n’existe pas. En revanche, le TAC-SC est au cœur des politiques de mobilité et de l’innovation scientifique par sa capacité à être optimisé et déclenché en temps réel, à bénéficier d’une information voyageur précise et à proposer des solutions d’information/divertissement aux usagers. Le TAC-SC sous forme de mini bus pourrait ainsi constituer une offre de transport à la fois partagée, flexible, durable (viabilité économique, environnementale et sociale) et complémentaire des solutions de mobilité existantes. |
| collaborations SCIENTIFIQUES |
Salma BOUDIAF

Salma BOUDIAF
Doctorante
| titre de la thèse | le Risque de tsunami au Maroc : facteurs de Vulnérabilités et de Résiliences | ||
| terrains d’études |
|
||
| (co-)directeurs |
Directeur de Thèse M. Frédéric Leone co-directeur de Thèse M. Bendahhou Zourarah |
||
| ORIGINE DU financement |
|
||
| résumé de la thèse |
|
||
| collaborations SCIENTIFIQUES |
– Laboratoire en France : L’Université Paul-Valéry Montpellier 3, Montpellier, Maroc – Laboratoires à l’étranger :
|
Camille GROS

Camille GROS
Doctorante
| cgros34@gmail.com | |||
| titre de la thèse |
Améliorer les pratiques de gestion de crise en optimisant l’apprentissage par les exercices et l’intégration des spécificités territoriales. Simulations de crise et retours d’expérience d’événements d’origines naturelle et technologique |
||
| terrains d’études |
|
||
| (co-)directeurs | Frédéric Leone | ||
| ORIGINE DU financement |
|
||
| résumé de la thèse |
|
||
| collaborations SCIENTIFIQUES | Projet Interreg ADAPT & REACT : Renforcement des capacités d’adaptation et de gestion de crise face aux risques Climatiques en Territoire Caribéen (coord. : Université des Antilles, Guadeloupe |
Marie KARPOFF

Marie KARPOFF
Doctorante
| marie.karpoff@univ-montp3.fr | |||
| titre de la thèse | Acteurs, échelles et enjeux territoriaux de la coopération internationale pour l’adaptation au changement climatique dans la Caraïbe insulaire. Des arènes politiques globales aux initiatives locales. | ||
| terrains d’études |
|
||
| (co-)directeurs | Lucile MEDINA et Stéphanie DEFOSSEZ | ||
| ORIGINE DU financement |
|
||
| résumé de la thèse |
|
||
| collaborations SCIENTIFIQUES | Projet Interreg ADAPT & REACT : Renforcement des capacités d’adaptation et de gestion de crise face aux risques Climatiques en Territoire Caribéen (coord. : Université des Antilles, Guadeloupe |
Wale Abdulgafar AYANTOLA

Wale Abdulgafar AYANTOLA
Doctorant
| ayantolawale@gmail.com | ||
| titre de la thèse | Investigating Public on Transport and Mobility Behaviours: A Systemic and Gender Approach in Ilorin, Nigeria | |
| terrains d’études |
|
|
| (co-)directeurs | Dr Sofiat Belghiti – Muhut and Dr Adrien Lammoglia | |
| ORIGINE DU financement |
|
|
| résumé de la thèse |
|
|
| collaborations SCIENTIFIQUES |
Helsa-Mignonne MENGUE MEDZEGUE

Helsa-Mignonne MENGUE MEDZEGUE
Doctorante
| Pelzangel2005@gmail.com | ||
| titre de la thèse | Géopolitique de la baie de Corisco : Acteurs, Enjeux et Perspectives. | |
| terrains d’études |
|
|
| (co-)directeurs | Lucile MEDINA-NICOLAS et Stéphanie LIMA | |
| ORIGINE DU financement | Bourse d’étude | |
| résumé de la thèse | Notre analyse sur la baie de Corisco propose notamment une approche sur les frontières maritimes conflictuelles. En réalité, la démarcation des frontières s’est avérée et amplifiée au Gabon et en Guinée Equatoriale suite à la proclamation des indépendances en 1960. Ainsi en tant qu’Etat, chacune des colonies pour leur sécurité et leur souveraineté a dû procéder à la fixation de ses frontières terrestres et maritimes. Puis avec la mise en place de la convention de Montego bay en 1982, le Gabon et la Guinée Equatoriale procèdent à leurs extensions maritimes unilatérales. Ces extensions de leurs eaux territoriales visant à englober l’espace disputé, entraînent des chevauchements réciproques de leurs territoires maritimes. Ce qui crée le conflit frontalier qui prévaut entre ces deux Etats sur leur dyade maritime. Cette situation a nécessité l’intervention et la médiation des nations unies et la cour internationale de justice afin de mettre fin au conflit mais sans succès. En portant notre étude sur ces deux Etats, nous allons examiner les différentes thématiques qui seront le fil conducteur de notre recherche en trois parties. Tout d’abord, nous devons mener une analyse diachronique de cet espace ainsi que les différents facteurs afin d’expliquer la présence et le rôle de chaque acteur. Ensuite, nous allons nous interroger sur les différents enjeux et leurs impacts afin de mieux cerner la situation qui prévaut dans cet espace. Pour finir, nous allons reconsidérer les perspectives proposées ainsi que les politiques de développements transfrontaliers qui permettent de mettre fin au conflit et que tous les acteurs tirent profit de la baie. | |
| collaborations SCIENTIFIQUES |
David FAU

David FAU
Doctorant
| Davidfau85@gmail.com | ||
| titre de la thèse | L’Ile Maurice à l’épreuve des risques naturels : analyse des trajectoires de vulnérabilité par une approche géohistorique | |
| terrains d’études |
|
|
| (co-)directeurs | Nancy Meschninet de Richemond | |
| ORIGINE DU financement | personnel | |
| résumé de la thèse |
Cette thèse a pour objectif d’explorer les trajectoires de vulnérabilité de l’Ile Maurice face aux risques naturels en adoptant une démarche géohistorique. Cette approche permet de comprendre l’évolution des vulnérabilités dans un contexte insulaire et soumis au changement climatique. L’Ile Maurice, en tant que Petit État Insulaire en Développement (PIED), présente des vulnérabilités propres aux espaces insulaires : isolement, limitation des ressources, exigüité du territoire, littoralité. La thèse, tout en s’appuyant sur un constat des vulnérabilités actuelles et une prise en compte de l’exposition physique aux aléas, dépassera ce cadre et inclura des facteurs explicatifs d’ordres historiques, économiques et sociaux. Ce travail de recherche permettrait de mieux comprendre la co-construction entre un territoire insulaire et des évènements naturels dommageables dans un contexte tropical. Un jeu d’échelles sur les territoires environnants (Réunion, Madagascar, Seychelles) serait également intéressant à développer dans une perspective comparatiste, et permettrait ainsi d’approfondir la connaissance sur la gestion des risques naturels par un PEID. Façonnée par ses interactions avec la mondialisation depuis le début de sa mise en valeur économique et démographique, l’Ile Maurice a accueilli diverses populations, issues de mondes éloignés, et aux intérêts souvent antagonistes. Le creuset culturel original qui en découle sera étudié par le prisme de la « créolité », telle que définie par le poète martiniquais E. Glissant. Tandis que le « communalisme » mauricien, en tant que système politique structurant la société mauricienne sur des bases ethniques et religieuses, sera analysé en détail pour déceler son influence dans la gestion des risques naturels. Développer une recherche sur un temps long, et en croisant les échelles géographiques permettrait de faire avancer la recherche en géohistoire, et notamment sur le thème de la mondialisation. Cette perspective permettrait d’étudier les influences et rétroactions qu’entretiennent mondialisation et risque. L’île étant intégrée à un système mondialisé, elle rétroagit sur celui-ci en faisant peser le poids du risque sur des espaces qui sont très éloignés les uns des autres, mais reliés entre eux à travers un objectif commun, l’exploitation commerciale du territoire mauricien. Néanmoins, avant d’aller plus avant dans cette réflexion, il convient de questionner la notion même de vulnérabilité en fonction des époques, afin de ne pas tomber dans l’anachronisme. La prise en compte du cadre de pensée des acteurs à différents pas temporels est importante pour comprendre les processus de création des vulnérabilités. Il est également nécessaire d’élargir la réflexion sur ce sujet à d’autres espaces plus ou moins lointains, mais intrinsèquement liés aux caractéristiques locales. Dans cette optique, il sera pertinent d’interroger la notion de frontières. L’analyse contextuelle et historique des trajectoires de vulnérabilité de l’Ile Maurice dans une perspective postcoloniale viendra enrichir les notions et les paradigmes utilisés localement dans la gestion des risques naturels. |
|
| collaborations SCIENTIFIQUES |
Sana BOUGHAMOURA

Sana BOUGHAMOURA
Doctorante
| titre de la thèse | La valorisation touristique du patrimoine géomorphologique : le cas du Nord-Ouest des Matmatas (Sud-Est Tunisien) | |
| terrains d’études |
|
|
| (co-)directeurs | Frédéric Leone – Noômène Fehri | |
| ORIGINE DU financement | Sans financement | |
| résumé de la thèse |
Le paysage géomorphologique désigne l’ensemble des caractéristiques visibles de la surface terrestre, qui ont été progressivement modifiées au fil du temps par divers processus géologiques et géomorphologiques. Le paysage géomorphologique peut être considéré comme un patrimoine précieux grâce à sa richesse culturelle, spécifiquement les biens architecturaux, monuments historiques, œuvres littéraires, etc., et naturelle, notamment les canyons, les héritages quaternaires, la lithologie. Ce patrimoine géomorphologique commence à faire l’objet d’une attention accrue de la part des scientifiques et des acteurs du territoire, en raison des menaces grandissantes qui pèsent sur la préservation des reliefs et des paysages, mais aussi compte tenu des potentialités qu’offre la valorisation culturelle et touristique des sites d’intérêt géomorphologique (ou géomorphosites) pour le développement local (Bétard, 2015). Dans ce contexte, et après le développement de l’état de l’art des études de valorisation géotouristique, dans le monde, et en particulièrement en France et dans le nord de l’Afrique nous allons essayer de mettre l’accent sur un cas d’étude dans le sud est tunisien. Il s’agit de la région du Dahar septentrionale et plus précisément dans les Matmatas. Cette dernière renferme un patrimoine très riche et d’une grande valeur. Cependant, aujourd’hui, ce patrimoine est menacé par le risque d’abandon et la prolifération de l’érosion. Ce qui nécessite de mettre en place des mesures de protection et de valorisation de ce précieux héritage. Un héritage qui ne peut que participer dans le développement local et à l’amélioration des conditions de vie à partir d’une mise en place d’une stratégie de valorisation des ressources patrimoniales afin de créer des opportunités économiques locales. La méthodologie de travail repose en premier lieu sur une approche analytique des recherches antérieurs et des enquêtes basés sur les pratiques internationales et nationales et les modalités de mise en œuvre de patrimoine géomorphologique. Une approche cartographique sera développée en deuxième lieu pour ce travail. Une telle approche repose la cartographie géomorphologique et géotouristique toute en se basant sur la méthode globale de l’étude des géomorphosites développée de l’université de Lausanne (UNIL). |
|
| collaborations SCIENTIFIQUES | Biogéographie, Climatologie Appliquée et Dynamiques Environnementales, Université de la Manouba, Tunisie. |
Léa THOREL

Léa THOREL
Doctorant
| lea.thorel@mrn.asso.fr | |
| titre de la thèse | Analyse de la resilience du bâti assuré face aux aléas naturels |
| terrains d’études | |
| (co-)directeurs | Freddy VINET et Sarah GERIN (directrice de la Mission Risques Naturels) |
| ORIGINE DU financement | ANRT |
| résumé de la thèse |
Il est établi que les constructions résilientes sont réalisables, l’enjeu est à présent d’analyser la pertinence des mesures de résilience afin de les mettre en avant auprès des acteurs de la construction. Dans cette perspective, l’objectif principale de la thèse est de développer un outil opérationnel de Diagnostic de Performance de Résilience. Il intégrera l’étude de l’exposition aux risques naturels, des éléments de vulnérabilité et de la pertinence des mesures de résilience sous forme de scoring. Il en résultera une note finale qui reflétera le niveau de résilience du bien et de sa parcelle ainsi qu’une aide à la priorisation des investissements sur les travaux améliorant la performance à la résilience. |
| collaborations SCIENTIFIQUES |
Justine PANEGOS

Justine PANEGOS
Doctorante
|
|
|
| titre de la thèse | Analyse multirisque de la vulnérabilité des coopératives viticoles dans un contexte de transitions et de mutations |
| terrains d’études | France métropolitaine |
| (co-)directeurs | Freddy Vinet (Directeur) et Frédéric Grelot (Co-Directeur) |
| ORIGINE DU financement | ADEME |
| résumé de la thèse | L’agriculture se situe au carrefour des enjeux posés par le changement climatique, identifiée à la fois comme problème et solution. Particulièrement exposées aux événements climatiques, les exploitations agricoles doivent s’adapter pour être plus résilientes et participer à l’atténuation du changement climatique à long terme. Les modifications attendues de la fréquence, de l’intensité voire de la saisonnalité des aléas hydro climatiques font peser une menace à court terme sur la viabilité économique des exploitations agricoles, déjà fragilisées par des contraintes de long terme en lien ou non avec le changement climatique, qui les incitent à une évolution «transitionnelle ». Les coopératives viticoles ont vu le jour dans le but de mutualiser les moyens individuels, pour mettre en oeuvre une transition qualitative et faire face aux défaillances du marché. Encore largement présentes dans le paysage viticole de nos jours, quels rôles peuvent-elles jouer pour permettre aux exploitations de faire face aux changements du climat à court terme et de s’adapter sur le long terme tout en s’inscrivant dans des transitions économiques et environnementales ? À ce jour, les interactions entre les risques climatiques tout comme les implications des évolutions transitionnelles dans l’adaptation des systèmes coopératifs au changement climatique ne sont pas traitées. La thèse propose de traiter trois objectifs autour des systèmes coopératifs viticoles dans un contexte multirisques climatiques et de transitions : caractériser leur exposition, évaluer leur vulnérabilité et traduire les trajectoires de vulnérabilité en trajectoire d’adaptation. La thèse s’inscrit en géographie et repose sur des outils de cette discipline : cadrage conceptuel à partir d’analyse de littérature, analyses spatiales et cartographiques, enquêtes semi-directives et fermées auprès des acteurs du secteur. Elle mobilise également des approches de modélisation des processus pour l’évaluation de la vulnérabilité. Une forte interaction avec les partenaires locaux (via des ateliers participatifs) est envisagée pour consolider la pertinence des modèles et élaborer des trajectoires d’adaptation adaptées à leur situation. |
| collaborations SCIENTIFIQUES |
Mohamed DIA

Mohamed DIA
Doctorant
sfonds
| Mouhadia148@gmail.com | |
| titre de la thèse | Reconfiguration des migrations ouest-africaines: une approche par les nouvelles routes méso-américaines vers les États-Unis. |
| terrains d’études | Mexique et États-Unis |
| (co-)directeurs | Lucile Medina |
| ORIGINE DU financement | fonds propre |
| résumé de la thèse | Les migrations ouest-africaines aux États-Unis s’inscrivent dans un processus de reconfiguration du phénomène migratoire. En effet la tendance migratoire a changé vers les années 1960 après les indépendances avec l’émergence des déplacements à l’échelle internationale. C’est vers les années 1970 que les migrations ouest-africaines ont augmenté de manière considérable à l’échelle transcontinentale s’accompagnant d’une diversification des lieux de destination. Ainsi, de façon moins visibilisée, mais progressive, depuis les années 1980 l’immigration ouest-africaine aux États-Unis a augmenté. Cette croissance migratoire a poussé les États-Unis à externaliser la lutte contre l’immigration clandestine en Amérique centrale et au Mexique. Le renforcement des contrôles frontaliers a poussé les migrants à inventer de nouvelles manières de voyager afin de déjouer les dispositifs mis en place. Les migrants ouest-africains utilisent aujourd’hui des itinéraires détournés pour atteindre leur destination. Plusieurs chemins sont utilisés mais celui par le Nicaragua et ensuite la remontée de l’Amérique centrale et du Mexique pour atteindre Tijuana semble le plus emprunté par les migrants en provenance de l’Afrique de l’Ouest. En centrant cette étude sur un terrain géographiquement ouvert à savoir l’Amérique centrale, le Mexique et les États-Unis, nous nous interrogerons principalement sur des thèmes qui s’articuleront autour de trois parties. Il s’agira d’étudier dans un premier temps l’évolution des flux migratoires ouest-africains en Amérique centrale et au Mexique ainsi que les facteurs déclencheurs, puis nous aborderons dans un deuxième temps les trajectoires des migrants, leurs profils et les difficultés rencontrées en cours de route, de même que les impacts de ces migrations sur les territoires en Amérique centrale et au Mexique. Dans la troisième partie nous tenterons de montrer comment cette migration est prise en considération aussi bien en Afrique de l’Ouest et sur le continent Américain et montrer qu’une meilleure coopération entre états peut accompagner ou freiner cette immigration clandestine. |
| collaborations SCIENTIFIQUES |
Anaïs COULON

Anaïs COULON
Doctorante
& del’En
| anais-windowspro@live.fr | |
| titre de la thèse | Quel avenir pour les littoraux de Saint-Barthélemy ? Des processus côtiers aux stratégies globales de gestion et d’adaptation des zones côtières |
| terrains d’études | Saint-Barthélemy – Antilles françaises |
| (co-)directeurs | Tony Rey & Stéphanie Defossez |
| ORIGINE DU financement | CIFRE : ANRT & Agence Territoriale de l’environnement (ATE) de Saint-Barthélemy |
| résumé de la thèse | Les littoraux de Saint-Barthélemy sont soumis à une pression anthropique croissante. Or, ces interfaces sont des espaces fragiles et fortement exposés aux menaces naturelles (inondations, submersions marines, érosion, tempêtes, cyclones) et en première ligne des effets du changement climatique. Dans ce contexte, la gestion du littoral de Saint-Barthélemy et des risques associés est de plus en plus perçue comme un préalable indispensable à une gestion durable de ces territoires vulnérables. Mais cette gestion se heurte à des enjeux de développement économique, à la patrimonalisation croissante et à de multiples conflits d’usages. Une évaluation systémique et transcalaire des vulnérabilités physiques et structurelles de l’île rendra possible l’identification de stratégies de gestion et d’adaptation les plus efficientes, réalistes et innovantes, selon différentes temporalités, pour ce territoire en développement, au foncier limité et soumis aux pressions immobilières, le tout dans le contexte du changement climatique avec les nouvelles réalités que ce dernier impose. |
| collaborations SCIENTIFIQUES |
Projet FUTURISKS Nouvelle-Calédonie LAGAM : Risques côtiers passes à futurs dans les territoires d’Outre-mer insulaires tropicaux : des impacts aux solutions (Coord. : Virginie DUVAT & Xavier BERTIN, UMRi LIENSs 7266).
Projet CoaST-Barth LAGAM (coord. Tony REY & Stéphanie DEFOSSEZ) |
Miangaly RAKOTO

Miangaly RAKOTO
Doctorante
.
|
|
|
| titre de la thèse | Innovation et gestion territorialisée des risques en France. Contribution des géographes à la réduction des risques et des catastrophes |
| terrains d’études | France métropolitaine |
| (co-)directeurs | Nancy Meschinet de Richemond et Stéphanie Defossez |
| ORIGINE DU financement | sans financement |
| résumé de la thèse | En 2022, 4813 personnes sont décédées en France à cause de catastrophes hydrométéorologiques et climatiques (BD EM-DAT). Selon le dernier rapport du GIEC, la progression du réchauffement climatique causera une hausse des impacts de ces catastrophes sur les sociétés. Les préoccupations concernant changements climatique et risques naturels ne sont pas nouvelles. 2005 marque l’entrée en vigueur du Protocole de Kyoto, produit de la gouvernance internationale, et l’adoption du Cadre d’action de Hyōgo. Il influence l’orientation des politiques nationales de gestion des risques entre 2005 et 2015 et débouche en 2007 sur l’entrée en vigueur de la « Directive inondations » européenne, transposée dans le droit français en 2010. Or, la prévention réglementaire des risques existe en France depuis le début du XVIIIème siècle, produit d’héritages sociaux et culturels anciens. La gouvernance internationale des risques et des catastrophes qui émerge à travers le Cadre d’action de Hyōgo puis celui de Sendai lui succédant en 2015 complexifie les tensions entre les paradigmes de la GRR mais aussi entre les échelles territoriales et temporelles dans lesquelles s’inscrivent les risques. Avec son approche territorialisée des risques, la géographie constitue une opportunité de réconciliation des héritages historiques forgeant le territoire français et les innovations scientifiques et techniques qui y sont introduites sous l’influence de la gouvernance internationale. En examinant les diverses influences de cette tension, cette étude éclairera les limites et atouts de la contribution des géographes à la gestion et à la réduction des risques et des catastrophes en France. |
| collaborations SCIENTIFIQUES | FR-Alert : convention de partenariat Avignon Université/DTNUM/BASEP |
Damien VIEILLEVIGNE

Damien VIEILLEVIGNE
Doctorant
| titre de la thèse | Les entrées de ville en France : enjeux d’aménagement et potentiel écologique |
| terrains d’études | Entrées de ville de la métropole de Montpellier plus autres terrains à définir |
| (co-)directeurs | Alexandre Brun |
| ORIGINE DU financement |
|
| résumé de la thèse | 70 ans après l’essor de l’urbanisme commercial en France, les entrées de villes se sont considérablement étendues aux dépens des campagnes alentours. Elles symbolisent l’évolution du rapport ville-campagne et le processus de périurbanisation. Mais bien que les entrées de villes soient un terme récurrent de recherche, beaucoup d’interrogations restent en suspens sur ce terme polysémique et sur ses potentialités en termes de contribution à la renaturation des villes. En empruntant alors à l’écologie urbaine les réponses opérationnelles qui s’esquissent, cette recherche vise à explorer les potentialités des entrées de villes comme leviers de la renaturation. Dans cette optique, la thèse propose une tentative de définition précise et actualisée des entrées de ville, et interroge les externalités qu’elles pourraient générer sur le territoire. Le futur des entrées de villes est lui aussi à interroger dans une dynamique juridique actuelle de limitation de l’étalement urbain et de protection voire de restauration de continuités écologiques. Dès lors, les entrées de villes peuvent être conceptualisées comme les éléments constitutifs potentiels d’un système urbain rhizomique en rupture avec l’urbanisme de zone et dans lequel ville et nature peuvent trouver une nouvelle relation dynamique. |
| collaborations SCIENTIFIQUES | – |
Chloé COUAILHAC

Chloé COUAILHAC
Doctorant
| chloe789@hotmail.fr | |
| titre de la thèse |
Comment réinvestir et revitaliser les centres-villes anciens en milieu rural ? |
| terrains d’études |
France métropolitaine, région Occitanie |
| (co-)directeurs |
Pascal CHEVALIER (directeur), Stéphane BOSC (co-directeur) |
| ORIGINE DU financement | Aucun |
| résumé de la thèse |
La thèse porte sur la question du déclin des centres anciens dans les territoires ruraux d’Occitanie. Cette recherche passe par l’étude des causes de cet abandon, ses différentes étapes jusqu’à aujourd’hui et les possibles réinvestissements sous la forme de restructurations de l’habitat, du tissu urbain et du réseau commercial. L’enjeu de ce travail est d’arriver à faire ressortir et communiquer les avantages et qualités de vie que les centres-villes proposent aux habitants, de les amplifier et de les compléter par des qualités nouvelles considérées aujourd’hui comme essentielles : « le logement collectif, l’ensemble locatif peuvent avoir une autre image : – Ils peuvent s’intégrer au site et s’enrichir de sa complexité. / – Ils peuvent être accueillants, avoir une capacité réelle de socialisation. / – Ils peuvent s’enrichir de signes. / – Ils peuvent avoir une grande aptitude d’adaptation et de transformation. »1 Redynamiser les centres anciens passerait conjointement par un réaménagement urbain et un travail sur l’habitat existant pour l’adapter aux besoins actuels tout en conservant sa valeur historique et patrimoniale. Un paramètre décisif dans le déclin des centres-villes est le développement de la place de la voiture dans la société, elle représente aujourd’hui un point de tension pour le réinvestissement des centres : Comment trouver l’équilibre entre sécurisation de la déambulation piétonne et l’accès direct au logement en voiture ? La dimension économique est également primordiale, les centres ne peuvent pas être réinvestis sans une activité économique pérenne : Comment rendre le centre attractif aux commerces et services ? Contrairement au monde urbain dans lequel la pression foncière est si intense que les centres continuent d’être habités, les centres-villes des mondes ruraux quant à eux sont abandonnés au profit des périphéries plus abordables, sécurisées et représentant une réussite sociale. |
| collaborations SCIENTIFIQUES |
Marvin GERMAIN

Marvin GERMAIN
Doctorant
| titre de la thèse | Information géographique et cartographie en ligne pour la gestion des risques et des crises d’origines naturelle et technologique | |
| terrains d’études |
|
|
| (co-)directeurs |
|
|
| ORIGINE DU financement |
|
|
| résumé de la thèse |
Cette thèse de doctorat questionne l’usage de l’information géographique pour la gestion des risques et des crises en considérant notamment l’essor des Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication (NTIC) dans ce domaine. Les recherches visent à analyser un échantillon de plateformes et de rendus cartographiques en ligne recensés aux échelles nationales et internationales, afin de déterminer les bonnes pratiques, convergences, et divergences, au regard des méthodes actuelles. Suite à cet état de l’art, plusieurs expérimentations sont menées. L’objectif est de capitaliser des retours utilisateurs afin d’alimenter un prototype web cartographique opérationnel développé par la société RisCrises. Cette thèse alimente également un catalogue de géo indicateurs multirisques et multi échelles, réalisé à partir de données collectées ou open access. Il consiste à définir un référentiel cartographique pour la gestion des risques et participe à l’alimentation de la plateforme cartographique. Enfin, les recherches interrogent également l’adaptation des règles de sémiologie graphique et d’optimisation cartographique, appliquée aux nouvelles pratiques en ligne.
Une fois la plateforme d’aide à la décision livrée, de nouvelles expérimentations seront menées dans le but de tester son ergonomie et son interactivité, en vue de l’optimiser et d’assurer son opérationnalité. Dans ce cadre, l’ANR FUTURISKS à laquelle sont adossées ces recherches, permettra notamment de tester et de mettre en application la plateforme web cartographique au service des gestionnaires de crise de l’Outre-mer français. |
|
| collaborations SCIENTIFIQUES | ANR FUTURISKS | |
| PUBLICATIONS | https://www.linkedin.com/in/marvin-germain/ |
Llewella MALEFANT

Llewella MALEFANT
Doctorant
| malefant.llewella@gmail.com | ||
| titre de la thèse | Vieillissement de la population et aménagement du territoire : explorations dans la « diagonale des faibles densités » | |
| terrains d’études |
|
|
| (co-)directeurs |
|
|
| ORIGINE DU financement |
|
|
| résumé de la thèse |
Et si l’avenir des territoires passait également par les séniors ? Ce projet de thèse défend le postulat que les seniors, de plus en plus nombreux, sont une chance pour les territoires, en particulier ceux qualifiés de “périphériques”. La spécialisation territoriale dédiée aux seniors a en effet l’avantage de générer des emplois non délocalisables et dissociés des crises conjoncturelles. Les personnes âgées exigent des emplois de services variés, continus et locaux, au contraire, par exemple, des emplois industriels dont nombre de petites villes sont tributaires – à l’image de Figeac, dépendante de l’aéronautique. Outre l’emploi, la silver-territorialisation ouvre également des perspectives en matière d’aménagement du territoire car des solutions adaptées à chaque famille, à chaque cas (en fonction de son état de santé, de ses revenus, de sa situation familiale, etc.) sont désormais à rechercher entre le maintien à domicile et la “maison” spécialisée. Cette recherche-action place au centre de la réflexion le triptyque aidant-soignant-patient. Grâce à des enquêtes auprès d’experts et d’acteurs locaux ainsi qu’à l’exploitation cartographique de données récentes et fiables à l’échelle de plusieurs sites-pilotes, elle développe l’hypothèse qu’il existe des convergences opérationnelles entre les stratégies propres au vieillissement de la population et celles relatives à l’habitat, aux mobilités et à l’environnement. L’objectif de la thèse est précisément d’évaluer dans quelle mesure le chantier du vieillissement constitue une opportunité de développement durable pour les territoires, et si oui, où et sous quelles conditions exactement afin d’en estimer les retombées économiques et sociales notamment. |
|
| collaborations SCIENTIFIQUES |
Manuela HABIB

Manuela HABIB
Doctorant
| Manuellahabib1@hotmail.com | ||
| titre de la thèse |
Résilience urbaine et approche systémique des risques. Analyse du processus d’adaptation du quartier de Mar Mikhael à Beyrouth après l’explosion de la zone industrialo-portuaire en 2020. |
|
| terrains d’études |
|
|
| (co-)directeurs | M. BRUN Alexandre et Mme MESCHINET DE RICHEMOND Nancy | |
| ORIGINE DU financement | Sans financement | |
| résumé de la thèse |
Les conséquences humaines et matérielles de l’explosion du port de Beyrouth rappellent la vulnérabilité des aménagements et des infrastructures du Liban face aux risques industriels et technologiques. Dans une perspective de transformation des dynamiques d’endommagement et de leur expansion au-delà du territoire de l’aléa, la « glocalisation » permet une lecture multi-scalaire des risques qui intègre la transformation des risques en menaces globales et systémiques. Dans ce contexte, la résilience pourrait être envisagée à la fois en tant qu’outil d’analyse des dynamiques territoriales observées après l’évènement et en tant que trajectoire interrogeant la gestion des risques qui peine à « agir local » tout en « pensant global ». Ce travail de thèse propose de se pencher sur les effets de la catastrophe de Beyrouth et sur les trajectoires de différents territoires urbains (quartier de Mar Mikhael, ville) ; suivant une approche d’étude multi-scalaire des risques intégrant l’analyse des vulnérabilités fonctionnelles de ces territoires et les jeux d’acteurs. |
|
| collaborations SCIENTIFIQUES |
Noël Philmon MZUNGU

Noël Philmon MZUNGU
Doctorant
| mzungunp@gmail.com | ||
| titre de la thèse | Approche pluridisciplinaire de la vulnérabilité des territoires au risque de retrait-gonflement des argiles (RGA) | |
| terrains d’études | France | |
| (co-)directeurs |
|
|
| ORIGINE DU financement | Bourse Cifre/Generali | |
| résumé de la thèse |
Les sols argileux ont tendance à changer de volume en fonction des conditions météorologiques. Ce phénomène appelé retrait-gonflements des argiles (RGA) ou sécheresse géotechnique, a des conséquences directes sur les structures légères construites sur ces terrains, en particulier les maisons individuelles. Pendant des années, le RGA n’a pas été considéré comme un problème en France jusqu’à ce qu’une succession d’épisodes, durant la décennie 1980 (1979, 1987, 1989), lui valent d’être officiellement reconnu et pris en charge dès 1989 par le régime des catastrophes naturelles « régime Cat Nat ». A ce jour, les sinistres dûs au phénomène de retrait-gonflement représentent le deuxième poste d’indemnisation du régime Cat Nat après les inondations (Mathon, 2018). Les sinistres RGA se caractérisent par un coût moyen très élevé : 16 300 euros (Cour des comptes, 2022). De plus selon France Assureurs (2021) le coût des sinistres RGA va tripler d’ici 2050. De nombreuses études ont été menées pour cartographier et bien comprendre le phénomène RGA avec notamment la contribution du Bureau de Recherches Géologiques Minières (BRGM) qui a publié deux cartes d’aléas. Ainsi, environ 48% des sols métropolitains français sont en niveau moyen ou fort RGA (BRGM, 2019) ce qui représente 10,4 millions de maisons individuelles exposées. A contrario, peu d’études se sont focalisées sur la propension au dommage, c’est-à-dire sur la vulnérabilité des bâtiments face à cet aléa. Ce doctorat propose donc une approche pluridisciplinaire de la vulnérabilité des bâtiments et des territoires (stock bâtimentaire) au Retrait Gonflement des Argiles (RGA). L’approche se propose de combiner une analyse “micro” (approches de génie civil et de mécanique) avec des modèles statistiques basés sur les observations de dommages. Enfin l’apport de la géographie et des techniques d’analyses spatiales multicritères (SIG) doivent permettre de “généraliser” la démarche pour la rendre opérationnelle à l’échelle métropolitaine.
Mots clés ; Retrait-gonflement des argiles, assurance, vulnérabilité, gestions des risques |
|
| collaborations SCIENTIFIQUES |
– Bureau de Recherches Géologiques Minières (BRGM), à ORLEANS, France – Generali Climate Lab (Generali France), SAINT-DENIS, FRANCE |
|
|
Lien linkedin |
https://www.linkedin.com/in/noel-philmon-mzungu-87a727134/ |
Jean-Clément ULLES

Jean-Clément ULLES
Doctorant
|
jean-clement.ulles@etu.univ-montp3.fr |
||
| titre de la thèse | Adaptation de l’offre intermodale de transport aux nouveaux rythmes urbains : vers un chrono-aménagement du bassin de mobilité montpelliérain | |
| terrains d’études |
|
|
| (co-)directeurs | Laurent Chapelon | |
| ORIGINE DU financement |
|
|
| résumé de la thèse | L’intermodalité est un principe d’organisation des transports qui vise à articuler différents modes afin de réduire l’utilisation de la voiture dans les déplacements, répondant en cela aux enjeux de la durabilité des transports. Cependant, nos rythmes de vie (de travailler, de consommer, etc.) ne sont pas toujours adaptés pour renoncer au tout-voiture au profit de l’intermodalité. À partir du cas montpelliérain et de son bassin de mobilité, la thèse interrogera l’adéquation de l’offre intermodale de transport aux temporalités urbaines et aux besoins des habitants, à travers la notion de chrono-aménagement. Elle a pour ambition de mieux orienter les politiques publiques de mobilité durable et d’accompagner les acteurs privés dans le développement de services innovants de mobilité. Pour ce faire, la thèse s’appuiera sur une analyse fine des besoins et pratiques de déplacements et sur l’évaluation de la performance territoriale des services intermodaux associant modes individuels et collectifs. | |
| Publication | Ullès J.-C. & Chapelon L., 2024, Les fondements théoriques et méthodologiques de la conception des logiciels d’accessibilité dans la recherche française en géographie et aménagement, Géotransports, n°20, pp.5-24, en ligne : https://www.geotransports.fr/num%C3%A9ro-20 | |
| Linkedin : | https://www.linkedin.com/in/jean-clément-ulles-625364218/ |
Maëlle BANTON

Maëlle BANTON
Doctorant
|
|
|
| titre de la thèse | Co-construction avec les citoyens de projets d’aménagement littoraux résilients en Occitanie : l’audiovisuel comme objet frontière dans l’hybridation présentiel/numérique |
| terrains d’études | Occitanie, France |
| (co-)directeurs | Sylvain Pioch, Elise Beck |
| ORIGINE DU financement | Projet AATRE |
| résumé de la thèse | Face aux nombreuses pressions que subit le littoral d’Occitanie, il est nécessaire de réfléchir à l’aménager de façon résiliente avec l’ensemble des acteurs du territoire : maîtres d’ouvrage, élus, experts… Mais aussi citoyens, car ces derniers sont encore très peu inclus dans les processus d’aménagement malgré leur demande croissante. Dans l’objectif initié par le projet AATRE (Agora de l’Aménagement des Territoires Résilients) de favoriser la co-construction de projets d’aménagement littoraux résilients en expérimentant des dispositifs de participation hybride entre présentiel et numérique, ce projet de thèse se demandera si l’audiovisuel peut être un dispositif qui permet une meilleure accessibilité au débat des citoyens. Il cherchera à développer une méthodologie d’outil audiovisuel accessible et applicable pour toute démarche de participation. Il pourra ouvrir les résultats de recherche sur les principes de la participation numérique couplée au présentiel, dans un cadre multi-conflictuel, le littoral. Sera proposée une démarche en trois temps. Premièrement, nous mènerons (1) un état de l’art afin de recenser et d’analyser les approches participatives actuelles pour les projets d’aménagement et les outils multimédias qui ont pu être développés et appliqués à ce domaine et (2) une étude des différents projets d’aménagement qui constituent le terrain d’étude et qui impliquent des modes de participation différents. Deuxièmement, nous entrerons dans la phase de construction et d’expérimentation des outils audiovisuels devant être adaptés à chaque cas. Troisièmement, la démarche visera à comparer les outils audiovisuels proposés pour en identifier le potentiel, les avantages et les limites, pour étudier la participation qu’ils ont engendrée et définir la méthodologie la plus performante- |
| collaborations SCIENTIFIQUES | – |
Baptiste BAUJARD

Baptiste BAUJARD
Doctorant
| titre de la thèse | Aménagement qualitatif de l’espace et développement local : les potentiels des Indications Géographiques Protégées Industrielles et Artisanales (IGPIA) en Occitanie | |
| terrains d’études | Occitanie | |
| (co-)directeurs | Marc DEDEIRE | |
| ORIGINE DU financement |
|
|
| résumé de la thèse |
La marqueterie de Revel, le couteau de Laguiole, le vase d’Anduze, la ferronnerie d’Arles-sur-Tech sont des exemples de la diversité des productions industrielles et artisanales locales en Occitanie. Pourquoi les territoires locaux ont-ils cet héritage et aujourd’hui qu’en font-ils et comment s’organisent-ils ? Les Indications géographiques sont une perspective de développement locale et régionale trop peu mobilisées car récentes. Chaque territoire peut organiser, repérer les ressources locales matérielles et immatérielles nécessaires à la création d’outils d’aménagement de leur territoire par la qualité de leurs productions. En France, douze IGPIA ont été introduite depuis 2014. Le lien exigé entre le produit et la zone géographique est plus souple que dans le cas d’une appellation d’origine mais suffisant pour conférer au produit des qualités, des caractéristiques (Granit de Bretagne) ou une réputation due notamment à la tradition ou à un savoir-faire local (exemple : Porcelaine de Limoges). |
|
Neyla MEDDAH

Neyla MEDDAH
Doctorant
|
||
| titre de la thèse | La monographie territoriale à l’épreuve des transformations politiques : développement urbain et aménagement dans la ville de Bizerte | |
| terrains d’études | Bizerte – Tunisie | |
| (co-)directeurs |
BRUN Alexandre TURKI Yassine |
|
| ORIGINE DU financement |
|
|
| résumé de la thèse |
Bizerte; la ville avec le point le plus septentrional de l’Afrique a été depuis sa genèse l’une des principales villes de la Tunisie. Mis à part sa situation stratégique à l’échelle internationale, Bizerte occupe une position privilégiée – mais problématique – à l’échelle nationale vu sa proximité de la capitale Tunis à 60 km/45min. Aujourd’hui, elle s’affirme de plus en plus comme partie intégrante de l’aire d’influence de la Métropole Capitale. Pendant ces dernières décennies, Bizerte a connu des mutations successives et profondes sur différentes échelles. Tout d’abord à l’échelle territoriale avec une accélération du phénomène d’urbanisation informelle d’un côté et des grands projets de l’autre motivés aussi bien par des dynamiques internes que par l’influence de la proximité de la ville capitale. Ensuite, à l’échelle environnementale avec un écosystème littoral et lagunaire sensible et menacé par les risques de pollution et d’érosion maritime. Sur le plan politique, avec un processus de transition démocratique post révolutionnaire et l’apparition d’une nouvelle mosaïque d’acteurs et un nouveau cadre réglementaire pour la gestion des affaires locales, les processus décisionnels autour du territoire ont connu une mutation profonde. Ces changements ont été également exacerbés par des processus externes notamment avec l’émergence de nouveaux concepts dont l’import au nouveau du territoire de Bizerte a été porteur de plusieurs enjeux. Ainsi, les modèles de villes durables et intelligentes, la démocratie participative, le pouvoir local ont été au centre de l’action locale pendant la décennie précédente. A travers une monographie de la ville de Bizerte qui interroge le territoire et ces processus, cette thèse essaye de mettre la lumière sur l’ensemble des transformations territoriales de ce territoire et sur les logiques qui les portent. |
|
| collaborations SCIENTIFIQUES | – |
Matar SECK

Matar SECK
Doctorant
| titre de la thèse | Evaluation des risques naturels et la planification de leur gestion du nouveau pôle urbain de Diamniadio |
| terrains d’études | Sénégal (pôle urbain de Diamniadio, Dalifort, Wakhine Nimzatt, Djidah Kaw) |
| (co-)directeurs | Tony Rey et Awa Niang Fall |
| ORIGINE DU financement | Aucun |
| résumé de la thèse |
Depuis une vingtaine d’année avec l’augmentation des aléas d’origine hydrométéorologique, Dakar, à l’image des autres agglomérations urbaines des pays du sud tel que Quito, Phnom Penh, Ibadan, Niamey, fait face à des risques naturels de plus en plus dévastateurs. L’accroissement galopante de la population, l’absence généralisée de planification urbaine et environnementale, l’occupation des zones non aedificandi, la non mise en place de réseaux structurant avant habitation, sont les facteurs qui augmentent la vulnérabilité des sociétés. Cette situation alarmante, au Sénégal, particulièrement à Dakar est fortement liée au retour des pluies et l’imperméabilité du sol. La forte attractivité de Dakar, combinée à un manque de prévention et de maîtrise dans la planification urbaine et à l’insuffisance des capacités des collectivités locales à assurer les compétences transférées, a produit des contrecoups négatifs liés principalement à l’étalement urbain, aux problèmes de mobilité urbaine, à des difficultés dans la satisfaction de la demande en eau et en électricité, en particulier au moment des pointes, à l’insalubrité, aux difficultés d’accès au logement, à l’occupation de zones tampons et de zones à risque favorisées, entre autres, par les effets liés à la baisse de la pluviométrie. Pour inverser cette tendance, et faire face à ces menaces environnementales en milieu urbain, dans son décret n° 2013- 1043 du 25 juillet 2013, l’Etat a défini une nouvelle politique d’aménagement du territoire, basée sur une vision d’organisation rationnelle et équilibrée de l’espace national et de valorisation optimale des ressources des territoires, l’image des pôles urbains de Diamniadio et du lac rose. Le pôle urbain de Diamniadio qui concerne notre projet de recherche, sera donc, une zone urbaine exposée à de nombreux aléas naturels qui peuvent impacter sa future population croissante, ses infrastructures, et ses activités telles que le retrait gonflement des sols et l’inondation par ruissellement constatés lors des visites de terrain. Et confirmer par les rapports techniques de la DGPU et de l’ADM. Ainsi, pour bien comprendre et cerner ces risques naturels, il faudrait examiner les éléments qui lui sont associés. En effet, ils dépendent d’un aléa, de l’exposition des personnes et des biens à cet aléa, et des conditions de vulnérabilité de la population. Ces facteurs qui évoluent dans le temps sont dans la plupart des cas aggravés, à cause des incapacités institutionnelles et individuelles ou des mesures inadaptées mises en œuvre pour faire face en vue de réduire le risque. Souvent dans les pays du tiers monde, les modèles socio-environnementaux du développement peuvent augmenter l’exposition et la vulnérabilité, et par conséquent, accroître les risques. La gestion des risques au Sénégal, reste cantonnée sur des approches centrées plutôt sur une approche globale, plus systémique. Cette option non globale traite les risques de manière séparée et les réponses apportées pour leurs gestions restent limitées et parfois inadaptées. En effet que ce soit le plan orsec, déclenché presque chaque année, le PROGEP (Le Projet de Gestion des Eaux pluviales et d’adaptation au changement climatique) 1 et 2, l’état sénégalais peine à régler le problème des inondations qui sévit surtout dans la banlieues dakaroises, faute d’absence ou d’une bonne politique de planification et gestion de risques naturels. Mon projet s’inscrit dans cette logique en essayant de voir, par une approche comparative entre un territoire déjà urbanisé et un territoire non urbanisé, comment imaginer une bonne planification territoriale aux enjeux environnementaux actuels et futurs ? Comment adapter une planification territoriale face à des menaces environnementales en particularité les pays du sud ? Qu’est ce qui a été fait avant et pourquoi ça n’a pas marché (limites et contraintes) ? Qui sont les acteurs de la gestion des risques naturels ? Comment faire pour rendre à la fois durable et résilient la nouvelle ville de Diamniadio. |
| collaborations SCIENTIFIQUES | Université Cheikh Anta Diop , Dakar, Sénégal |
Nadège TATY-MAKUNTIMA

Nadège TATY-MAKUNTIMA
Doctorante
| titre de la thèse | Diagnostic des vulnérabilités territoriales et gouvernance des épidémies des maladies infectieuses dans les pays à ressources limitées. Modèles développés en RDC sur les épidémies de choléra, de la Maladie à Virus Ebola et la maladie à corona virus. |
| terrains d’études | République démocratique du Congo |
| (co-)directeurs | Nancy Meschinet de Richemond, Jean Jacques Muyembe et Didier Bompangue |
| ORIGINE DU financement | Ministère des affaires étrangères Français via Campus France, Fondation VEOLIA, Prix Jeunes Talent 2020 l’Oréal Unesco de l’Afrique subsaharienne |
| année d’inscription | 2018 |
| résumé de la thèse |
En mars 2020, la pandémie de la COVID-19 a démarré en République démocratique du Congo sur fond d’épidémies multiples dont les plus emblématiques sont le choléra (premier cas en 1974) maladie endémique, et la MVE (premier cas en 1976), maladie épidémique en RDC. La gestion simultanée de ces événements de santé majeurs, dans un état fragile à ressources limitées, constitue une urgence humanitaire complexe. Dans le contexte actuel d’intensification et d’accélération des changements globaux, la maitrise de la dynamique des épidémies devient un enjeu sociétal majeur pour anticiper et mieux répondre à ces épidémies. Par la compréhension de trois modèles épidémiques à savoir le Choléra, la Maladie à Virus Ebola et la maladie à corona virus, ma recherche se propose d’adopter une approche transversale et pluridisciplinaire pour étudier la gestion des épidémies. En s’orientant vers la caractérisation des espaces en fonction de leur niveau de vulnérabilité, ce projet est l’un des premiers travaux à tenter un transfert méthodologique du diagnostic de vulnérabilité développé dans la gestion des risques naturels au LAGAM vers la gestion des risques épidémiques. L’objectif est de construire des indices de vulnérabilités territoriales adaptés aux épidémies. A travers des enquêtes de terrain, il s’agit également de s’intéresser à la perception des acteurs ainsi qu’aux pratiques sociales qui entourent les questions d’épidémies à chaque échelon de la gouvernance. Car les avancées scientifiques sur le fonctionnement d’une épidémie ne suffisent pas pour arriver à mieux contrôler les épidémies, il faut que les modes de gestion soient adaptés aux problèmes posés. Ma thèse vise à améliorer la résilience des territoires et des systèmes de gestion des épidémies à travers le ciblage des zones vulnérables et la mise en évidence des jeux d’acteurs et des limites de gouvernance à tous les échelons de la gestion de ces aléas récurrents. |
| collaborations SCIENTIFIQUES | Université de Kinshasa, Kinshasa, République démocratique du Congo |
| PUBLICATIONS |
Lien HAL : https://cv.archives-ouvertes.fr/nadege-taty-makuntima |
Zenepe DAFKU

Zenepe DAFKU
Doctorante
| titre de la thèse | Le développement socio-économique local grâce à l’utilisation optimale des ressources naturelles des zones protégées Étude de cas: Parc national de Divjaka Karavasta, Albanie. |
| terrains d’études | Albanie |
| (co-)directeurs | Pascal CHEVALIER et Natasha HODAJ |
| ORIGINE DU financement | Salariée Université Agricole de Tirana et Bourse ERASMUS PLUS |
| année d’inscription | 2020 |
| résumé de la thèse |
En Albanie, les espaces naturelles représentent environ 18% selon le territoire albanais (Ministère de l’Environnement, 2019).Malgré le fait que les AP présentent « théoriquement » un certain nombre d’avantages en termes d’environnement, de développement socio-économique, culturel et de développement territorial rural durable, ce qui se passe dans la réalité albanaise n’est pas ce que l’on attendait des forces de l’ordre mais aussi de l’environnement, du tourisme , stratégies de développement rural, etc. (Avantages des aires protégées (PA-BAT) en Albanie, 2019). Notre zone d’étude sera le parc national de Divjaka-Karavasta d’une superficie de 22230 ha soit 4,24% par rapport à la surface totale des aires protégées (ministère de l’Environnement, 2019), situé dans la partie centrale et sur la côte ouest de l’Albanie. Il est bordé au nord par la rivière Shkumbin, les collines de Divjaka à l’est par le bassin versant de Myzeqe et la rivière Seman au sud et à l’ouest par la mer Adriatique. La zone du parc est considérée avec une valeur très particulière de la nature et de la biodiversité. L’objectif principal sera:Développement socio-économique local grâce à l’utilisation optimale des ressources naturelles du parc national de DivjakaKaravasta à travers: La Détermination de l’utilisation optimale des ressources naturelles pour chaque groupe d’acteurs L’Efficacité économique des ressources / services écosystémiques pour le développement local de la zone. La Construction d’ une approche participative sur l’utilisation optimale des ressources naturelles. |
| collaborations SCIENTIFIQUES |
|
Fadia-Ahlem BENNACER

Fadia-Ahlem BENNACER
Doctorant
| fadiaahlem.bennacer@gmail.com | ||
| titre de la thèse | Quelle(s) est(sont) la(les) évolution(s) possible(s) du logement pavillonnaire dans les territoires ruraux ? | |
| terrains d’études |
|
|
| (co-)directeurs |
|
|
| ORIGINE DU financement | Aucun | |
| résumé de la thèse |
|
|
| Collaborations SCIENTIFIQUES | – |
Adrien POISSON

Adrien POISSON
Doctorant
| titre de la thèse | L’infrastructure cyclable comme levier dans la pratique du vélo : approches par les itinéraires et comportements des cyclistes. |
| terrains d’études | Montpellier Méditerranée Métropole |
| (co-)directeurs | Laurent Chapelon et Adrien Lammoglia |
| ORIGINE DU financement | Contrat doctoral Région Occitanie |
| année d’inscription | 2019 |
| résumé de la thèse | A Montpellier, comme dans de nombreuses villes en France, la part modale du vélo reste très faible (elle varie entre 4% et 7%). Les études, encore peu nombreuses sur ce sujet, font ressortir le rôle des aménagements, en particulier cyclables. Cependant, ce n’est pas parce que de nouveaux aménagements sont créés que de nouveaux cyclistes vont apparaître. Cette thèse cherche donc tout d’abord à mieux comprendre les cyclistes et les raisons qui les poussent à se déplacer à vélo, leurs comportements et leurs préférences, ainsi que les non-cyclistes, afin d’évaluer par la suite les effets des aménagements sur ces personnes. |
| collaborations SCIENTIFIQUES | ANR “Vélotactique”, (Lyon, Rennes, Montpellier, Paris, Grenoble, Bogota, Lausanne, Montréal) |
| PUBLICATIONS |
Eneida SHEHU (TOPULLI)

Eneida SHEHU (TOPULLI)
Doctorante
| etopulli@ubt.edu.al | |
| titre de la thèse | Détermination et automatisation de l’affiliation des typologies agricoles et de l’efficacité agricole en Albanie, vue par une approche géographique. |
| terrains d’études | Albanie |
| (co-)directeurs | M. Pascal CHEVALIER, M. Fatmir GURI |
| ORIGINE DU financement | Salariée Université Agricole de Tirana et Bourse ERASMUS PLUS |
| année d’inscription | 2020 |
| résumé de la thèse |
Les politiques agricoles en général se sont déjà déplacées vers l’investissement agricole direct. Leur conception et leur orientation optimales nécessitent une étude approfondie les caractéristiques des systèmes agricoles et les caractéristiques individuelles des exploitations. La création d’une typologie représentative à elle seule ne garantit pas la classification approfondie et la reconnaissance des caractéristiques individuelles des exploitations qui ne font pas partie de l’échantillon représentatif. En outre, le simple fait de connaître les caractéristiques de l’exploitation, sans mettre en évidence l’efficacité de l’utilisation des ressources n’est pas un instrument suffisant entre les mains des décideurs et des agriculteurs pour l’objectif principal des deux parties qui est d’augmenter la productivité. La littérature est pauvre avec des études sur la mesure de l’efficacité dans l’agriculture et encore plus avec l’étude de l’efficacité au niveau typologique pour le cas de l’Albanie. Le projet proposé visera d’abord à créer des instruments pour l’identification des systèmes agricoles (typologies d’exploitations) au niveau national et leur mise à jour. Il évaluera en outre l’efficacité de chaque typologie et automatisera l’affiliation des individus fermes aux typologies construites. L’objectif principal est de maximiser les avantages mutuels des décideurs et des agriculteurs respectivement dans la conception des interventions et la participation à l’intervention la plus efficace. |
| collaborations SCIENTIFIQUES | |
| PUBLICATIONS |
ha
rg
gs
